ANDRE LE MEUNIER
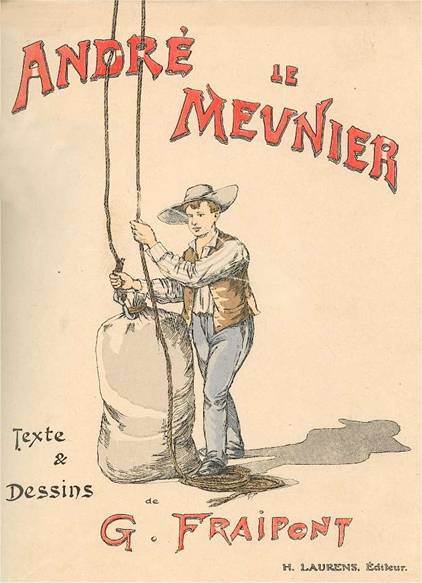
COLLECTION
"PLUME ET CRAYON"
CLOWN, par
A. Vimar.
JEAN-QUI-LIT
ET SNOBINET, par L. Métivet.
NOUVELLES
HISTOIRES SUR DE VIEUX PROVERBES, par G. Fraipont.
LES BONNES
IDEES DE PHILIBERT, par H. Avelot.
LE BOY DE
MARIUS BOUILLABES, par A. Vimar.
ANDRE LE
MEUNIER, par G. Fraipont.
GRAND'MERE
AVAIT DES DEFAUTS !... par Louis Morin.
LES ASSIEGES
DE COMPIEGNE, par A. Robida.
LA POULE A
POILS, par A. Vimar.
YVES LE
MARIN, par G. Fraipont.
PARIS EN
L'AN 3000, par Henriot.
L'ILE DES
CETAURES, par A. Robida.
LE TOUR DU
MONDE DE PHILIBERT, par H. AVELOT.
DELURETTE ET
LAMBINE, par L. Métivet.
LE TRESOR DE
CARCASSONNE, par A. Robida.
ARTHUR
VEUT…. ARTHUR NE VEUT PAS, par H. Avelot.
PATTARSORT,
par Pierre Noury.

L'ENFANCE LABORIEUSE
ANDRE LE MEUNIER
TEXTE ET
ILLUSTRATIONS
DE
G. FRAIPONT
PROFESSEUR A LA LEGION
D'HONNEUR

PARIS. – Henri
LAURENS, Editeur
6, Rue de Tournon,
6
1926
Tous droits de
traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
AUX
FILS DE MON AMI
G. D'ESPARBES
Affectueux
Souvenir.
G. F.
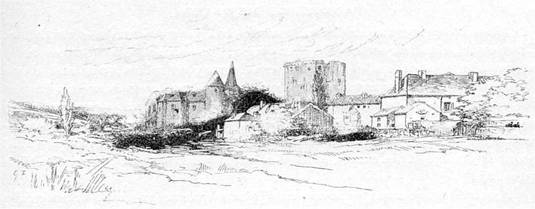
CHAPITRE PREMIER
UNE QUERELLE
- «... Je te dis de laisser ce petit
tranquille, sans cela tu auras affaire à moi, tu m'entends ?..
- « Mêle-toi donc de tes affaires, toi. D'abord,
ça n'te r'garde pas; t'es pas d'ici, t'es qu'un enfant trouvé, on l'sait ben
!... »
Celui auquel s'adressait cette apostrophe
était un beau garçon d'une douzaine d'années, robuste et bien bâti. Une
certaine distinction naturelle le faisait remarquer d'entre ses camarades
d'école, petits paysans des alentours. Très aimé de ceux-ci, il leur en
imposait pourtant, sans qu'il s'en doutât, par son air calme et sérieux et par
ses façons toujours polies, mais toujours fermes, de dire ce qu'il pensait. On
l'appelait André.
Son interlocuteur faisait avec lui une
vivante antithèse. Commun d'allures et de langage, passant son temps à la
maraude plutôt qu'à l'étude, on le voyait plus souvent dans les sentiers,
courant l'école buissonnière, que sur les bancs de sa classe, étudiant ses
leçons: c'était, en somme, une assez vilaine nature. Sa joie était de
tourmenter ses camarades, de leur jouer de méchants tours, mais il ne prenait
pour souffre-douleurs que de plus jeunes et plus faibles que lui.
André éprouvait pour ce jeune vaurien une
profonde antipathie. De nature généreuse, il ne pouvait admettre la lâcheté et
bien des fois il s'était interposé entre le tourmenteur et ses victimes; aussi
les petits venaient-ils souvent réclamer de lui aide et protection.
Aujourd'hui il avait été révolté envoyant
battre un pauvre petit bonhomme qui ne voulait pas prêter sa toupie, le seul
jouet qu'il possédât; aussi était-il bien décidé, si l'autre ne cédait tout de
suite, à lui donner une leçon dont il se souviendrait.
A cette injure: « Enfant trouvé! » André
avait d'abord été interloqué, puis, pâlissant de colère et perdant tout
sang-froid, il avait, d'un maître coup de poing, envoyé l'insulteur rouler dans
le fossé de la route. Tout poussiéreux et blême de rage, celui-ci s'était
relevé et courait sur son adversaire; mais André avait repris son calme; les
bras croisés, il dit froidement :
- « Et maintenant, devant tous, tu vas me faire des excuses... et tout
de suite, sans cela !... »
Devant l'air décidé d'André, l'autre, lâche
et couard, s'inclina et demanda pardon !...
La scène se passait à la sortie de l'école deSaint-Sernin-du-Bois, au pied des ruines féodales dont les hautes murailles et les tours pointues dominent les environs. Autrefois demeure seigneuriale et célèbre abbaye, les antiques bâtiments sont aujourd'hui la propriété d'un cultivateur du pays; la cour d'honneur s'est transformée en jardin, le chemin de ronde en potager.

Saint-Sernin-du-Bois est une petite commune située au nord du département de Saône-et-Loire, - non loin du Creusot dont les lourdes fumées obscurcissent l'horizon et à une vingtaine de kilomètres d' Autun, la vieille cité célèbre.
La mairie,
l'église, l'école, se trouvent à Saint-Sernin ; aussi les enfants des hameaux
d'alentour ont-ils souvent un assez long trajet à parcourir pour se rendre en
classe. André habitait à deux
kilomètres environ, au moulin du Mesvrin. Après la querelle il se mit en chemin
pour regagner sa demeure, mais ces mots: « Enfant trouvé », lui tintèrent de
nouveau aux oreilles...
- « Enfant trouvé! » se répétait-il... Et ce
fut tout à coup pour lui comme une révélation. Subitement il se rappela
certaines circonstances auxquelles jusqu'ici il n'avait pas prêté attention.
Des souvenirs lui reviennent en mémoire. Des pays d'aspect particulier se
dessinent à ses yeux... Il revoit un haut bateau aux épaisses
cheminées... Puis surgissent des figures autres que celles qui l'entourent à
présent...
Mais ces images sont vagues, comme voilées;
elles semblent vues à travers d'épais brouillards.
Sans prendre garde aux choses extérieures,
André fit ainsi le trajet de Saint-Sernin au moulin; sa préoccupation était
telle qu'il ne vit même pas les oies de « la Nanette » qui lui barraient
le chemin et qu'il faillit, en passant, leur écraser les pattes; elles
protestaient contre ce manque d'égards, allongeant vers lui leur long cou,
ouvrant grand leur bec jaune d'où s'échappaient des « chhhh... chhhh... »
furieux.
- « Oh ben! l'André, quoique té c'soir, te
vois donc pas clair? s'exclama la Nanette.
- « Pardon! mère Nanette, mais je pensais à
mes leçons, dit André, rougissant de son innocent mensonge.
- « Ben sûr ?.. C'est qu'té l'air tout «
beurdini » !
- « Mais non, Nanette, j'étais distrait,
voilà tout. Je ferai attention une autre fois... Excuse-moi! pour la peine je
vais t'aider à rentrer tes volailles. »
Et tous deux se dirigèrent vers le moulin où
la Nanette occupait un petit logement.
La Nanette était une vieille, vieille femme
du pays. Elle avait vu disparaître plusieurs générations et renaître plusieurs
générations nouvelles. Aussi était-elle connue dans toute la contrée. Elle
semblait être là de fondation et devoir y rester tant que le pays existerait.
On s'écriait ici :
- « C'est vieux comme la Nanette !
- « C'est connu comme la Nanette ! »
Ainsi qu'ailleurs on disait : « C'est vieux comme le Pont-Neuf, - c'est
connu comme le loup blanc. »
La Nanette était devenue proverbiale.
Pauvre, elle vivait moitié de ce qu'on lui donnait
et moitié de ce qu'elle gagnait en allant conduire les oies aux champs ou à la
rivière; on la voyait par tous les temps, entourée de ses volailles, assise sur
le bord de quelque talus, le menton dans la main ou bien, clopinant le long des
chemins, précédée de son régiment ailé.
Car elle boitait ferme, la pauvre vieille, et
ne pouvait guère déambuler qu'aidée de son bâton. Et c'était comique de la voir
dodelinant de droite et de gauche tout comme ses oies dont les cous se
balançaient en mesure. On l'avait baptisée: « Trois-Pattes ».
Ce n'était ni spirituel ni charitable.
Dans bien des campagnes, et notamment dans le
pays où nous nous trouvons, on a la singulière manie de débaptiser les gens ou
d'ajouter à leur nom de baptême un sobriquet généralement inspiré par certaines
habitudes, certaines manies ou certaines particularités morales ou physiques.
Tel était le cas de la Nanette.
Le surnom de « Trois-Pattes » lui était resté
à la suite d'une boutade, lancée par un paysan loustic qui, la voyant arriver loin derrière les autres, s'était
écrié :
- « Tins! regarde donc là-bas, la Nanette,
y'étot pas la peine d'avoir troè pattes, alle marche moins vite avec, que nous
autres qu'en avons qu'deux ! »
André, toujours préoccupé, allait à grandes
enjambées, chassant devant lui les oies sans plus 'penser à leur gardienne.
- « Eh! s'écria celle-ci, mais cours donc
point si vite, l'André, te sais ben que j'sons pas valide !!... »
Enfin on arriva au moulin.
La porte franchie, les oies, se sentant chez
elles, filèrent à toutes pattes, annonçant leur retour en cacardant éperdument,
tandis que canards et coqs leur souhaitaient la bienvenue par des « coins coins
» et des « cocoricos » assourdissants.

CHAPITRE II
LE MOULIN DU
MESVRIN
Des bâtiments tout enfarinés de la base au
faîte, poudrés de blanc partout et d'où l s'échappent des tic tac réguliers
indiquent un moulin; quelques pas encore et il n'y aura plus d'hésitation
possible; la grande roue tourne; tourne, brisant de ses palettes l'eau que lui
déverse la vanne grande ouverte.
La route, bosselée de pierrailles et de blocs
de granit, et les arbres qui la bordent sont blancs aussi, fardés des
poussières fines qui s'échappent des bâtiments, en légers brouillards.
Ces bâtiments encadrent une vaste cour où les
frimousses roses d'une colonie d'enfants grouillent joyeusement parmi les becs
jaunes ou gris et les crêtes cramoisies d'un régiment de volailles. Coqs
et poules picorent sur les tas de fumiers, des canards déambulent maladroitement
d'un air grave ou barbotent dans les mares en secouant leurs plumes; bêtes
et prétentieux circulent les dindons; ils s'arrêtent de temps à
autre pour faire la roue en lançant leurs ridicules « glouglous »
qui font trembloter leurs jabots sanguinolents.
Toutes ces bêtes (je parle des volailles)
trouvent là ample pâture dans les grains échappés des sacs, aussitôt retrouvés
par elles.
Les oies et les jars séjournent peu dans la
cour; sous la conduite de dame Nanette ils vont courir les grands chemins ou prendre
leurs ébats près des nénuphars qui étoiler l'étang de leurs pétales crémeux,
parmi les roseaux couronnés ici de panaches souples et là de fuseaux rigides
ressemblant à d'épais cigares plus qu'à des floraisons.

Le moulin comporte trois corps de bâtiments.
L'aile droite est occupée par « le » François
et «la » Julie Berluchot, les meuniers, et par « l'André » leur fils. Le
logement est simple mais fort bien tenu et ne manque pas d'un certain
confortable. Il se compose des chambres à coucher, celle des meuniers et celle
de leur fils, avec leurs lits classiques à rideaux rayés ou fleuris, quelques
chaises, une table ; d'une salle à manger servant aussi de « salle de réception
», car c'est là, en effet, qu'on se reçoit entre voisins ; la table et la huche
à pain en sont les meubles principaux, la vieille horloge à large balancier,
enserrée dans sa gaine de bois, le principal ornement.
La cuisine est à côté ; sur son fourneau de fonte cuit le ragoût qui fume, flairant bon, dans sa casserole de cuivre. Un étau, fixé au coin d'une table où sommeillent des paniers et des marmites, indique qu'à l'occasion la cuisine sert aussi d'atelier pour la réparation des outils ou l'ajustage de petites pièces de mécanique.
 L'étable,
où ruminent les boeufs qu'on attelle quand il s'agit d'aller aux villages
situés sur la montagne porter ou chercher de lourdes charges, puis l'écurie et
les remises forment les communs de ce côté. L'aile gauche, dont les meuniers
n'auraient que faire comporte le logement de la Nanette, celui des garçons et
du chasse-mulet ; le reste de cette aile est loué par petites
parties à des familles du pays, ouvriers d'usine partant tôt, rentrant tard -
et vice versa, car à tour de rôle ils ont une semaine de travail de nuit - et à
des petits cultivateurs possesseurs d'une nombreuse marmaille qui court et
criaille en ce moment dans la cour du moulin tandis que les « frères grands »
rentrent de l'école.
L'étable,
où ruminent les boeufs qu'on attelle quand il s'agit d'aller aux villages
situés sur la montagne porter ou chercher de lourdes charges, puis l'écurie et
les remises forment les communs de ce côté. L'aile gauche, dont les meuniers
n'auraient que faire comporte le logement de la Nanette, celui des garçons et
du chasse-mulet ; le reste de cette aile est loué par petites
parties à des familles du pays, ouvriers d'usine partant tôt, rentrant tard -
et vice versa, car à tour de rôle ils ont une semaine de travail de nuit - et à
des petits cultivateurs possesseurs d'une nombreuse marmaille qui court et
criaille en ce moment dans la cour du moulin tandis que les « frères grands »
rentrent de l'école.
Les deux ailes se rattachent au fond de la
cour par une assez spacieuse construction ; c'est le moulin proprement dit. Il
se compose d'un rez-de-chaussée et d'un premier, divisés l'un et l'autre en
compartiments : au rez-de-chaussée, les meules, les hangars; au premier, les
bluteries, la chambre à farines, etc.
Ne vous attendez pas à trouver ici le luxe
des minoteries modernes.
Nous sommes au Mesvrin, dans le vieux moulin
rustique, plus tout à fait le moulin de nos pères qui écrasaient tant bien que
mal leur grain entre deux meules, mais dans le moulin de campagne où le meunier
est véritablement meunier ; c'est la main de l'homme, non la machine, qui
travaille.
Dans les meuneries modernes, le blé arrive
mécaniquement et mécaniquement s'en retourne farine après avoir subi maintes
opérations.
Ici on va chercher, ou l'on apporte, dans de
primitives charrettes, le blé à moudre. Le meunier et ses aides le chargent sur
des diables, le transportent eux-mêmes aux meules, le font passer aux bluteries
; enfin, le travail fait, son et farine sont reportés à domicile ou attendent
qu'on les vienne chercher.
Point de machines compliquées amenant le blé, le débarrassant des brins de paille et des amas de poussière, le triant, séparant les gros grains des petits, les distribuant aux meules suivant leur grosseur.

Point de cylindres concasseurs où le blé est
écrasé avant d'être réduit en poudre sous les meules ; point d'engrenages pour
le transporter aux bluteries et le descendre ensuite automatiquement dans les
sacs qui s'en vont tout seuls sur leurs wagonnets.
Point de chaudières, points de volants, point
de pistons.
Une simple roue en bois, mue par une chute
d'eau (celle que nous avons aperçue tout à l'heure), est la seule force motrice
activant les rouages peu compliqués qui font tourner les meules.
 L'intelligence
du meunier doit se dépenser non seulement à surveiller la marche de son moulin,
à guider le travail, - qu'en partie il exécute lui-même du reste, - mais encore
à se faire des clients, à aller, avec sa voiture, en quête de ceux-ci dans les
hameaux souvent fort éloignés, à ramener leur grain, le moudre, le reporter une
fois transformé, car peu de villageois possèdent un véhicule et rares sont ceux
qui amènent et reprennent au moulin, en voiture attelé d'un cheval ou de bœufs,
leur grain ou leur farine.
L'intelligence
du meunier doit se dépenser non seulement à surveiller la marche de son moulin,
à guider le travail, - qu'en partie il exécute lui-même du reste, - mais encore
à se faire des clients, à aller, avec sa voiture, en quête de ceux-ci dans les
hameaux souvent fort éloignés, à ramener leur grain, le moudre, le reporter une
fois transformé, car peu de villageois possèdent un véhicule et rares sont ceux
qui amènent et reprennent au moulin, en voiture attelé d'un cheval ou de bœufs,
leur grain ou leur farine.
Le meunier doit sans cesse entretenir sa
clientèle, car nul n'est forcé de faire moudre ici plutôt que là.
Il y avait jadis dans le pays, comme dans
toutes les campagnes, du reste, un Moulin Banal ou Moulin à Ban où les serfs
devaient venir faire moudre leur grain moyennant redevance au seigneur. On
appelait Rannée l'obligation d'aller au moulin, et Verte-Moute le droit dû à ce
moulin.
Les paysans de Saint-Sernin et environs
étaient donc tenus de porter leur grain au Moulin-Banal de la contrée.
« … En oultre compette et appartient au
dict seigneur chacung an es moissons droit, pouvoir et faculté de prandre,
lever et percevoir et à son profit, appliquer la dixme sur ses dicts hommes et
sujets de sa dicte terre et seigneurie de Saint-Sernyn et par toute sa dicte terre..."
Dans certaines localités françaises et malgré
les lois abrogeant tous droits de banalité, il subsiste encore certains
vestiges des coutumes féodales, « banalités convenues entre une commune et un
particulier, non seigneur, et rentrant dans la catégorie des contrats ».
Il est toutefois interdit aujourd'hui aux
communes d'établir des banalités nouvelles ou de transformer en contrats celles
qui ont été supprimées comme féodales.
N'ayant donc aucun contrat, François
Berluchot ne pouvait compter que sur lui-même et, à l'exemple de ses confrères,
il devait aller chercher les clients à domicile puisque ceux-ci, libres de
choisir leur meunier, n'étaient nullement forcés de s'adresser au Mesvrin
plutôt que d'aller à Brandon, à Marmagne ou ailleurs, où d'autres moulins
tournaient.
Au début ce fut dur, car la concurrence était
grande ; mais notre homme y mit de la ténacité et s'efforça, non seulement de
faire de son mieux le travail récolté dans ses longues tournées, mais encore
d'être exact dans la livraison de ses commandes.
Une ou deux fois la semaine, Berluchot
attelait sa voiture et partait faire ses tournées gaiement, chantonnant,
claquant du fouet, tandis que sonnaillaient les grelots de son cheval qu'on
entendait ainsi venir de loin : « Tins! v'là le munié qu'passel » disaient les
gens du pays qui de loin reconnaissaient le carillon.
Et ceux qui avaient du grain à moudre
hélaient « le munié » au passage ; et plus on le hélait plus il était content,
plus il chargeait sa voiture en route et plus il rentrait joyeux au moulin.

Le plus clair des bénéfices du meunier est la
mouture pour le compte d'autrui ; il faut donc moudre beaucoup, toujours, pour
gagner son argent.
Suivant le désir des clients, et après entente avec eux, ceux-ci paient en monnaie courante ou laissent le meunier se payer lui-même sur la marchandise amenée, c'est-à-dire que le meunier prélève pour lui une quantité convenue de grain sur celui qu'on lui donne à moudre ; c'est ce qu'on appelle le « payement en nature ».
Certains meuniers, et Berluchot était de
ceux-là, achètent en outre des grains, en font de la farine qu'ils vendent
ensuite au commerce ou aux particuliers.
Au moment où nous vous présentons Berluchot,
il avait comme clientèle tous les campagnards des environs, son moulin marchait
à souhait. Il ne chômait jamais.
Sans cesse les sacs de blé entraient sous les
hangars du Mesvrin, s'y transformaient en sacs de farine qui, à leur tour, se
changeaient en sacs d'écus. Aussi le meunier passait-il dans la contrée pour
être « à son aise » ; un malin (?) avait composé à son endroit ce refrain naïf
devenu populaire :
C'est l'François Berluchot
Qu'a du foin plein ses sabots !
On ne lui en voulait pas trop de faire bien ses
affaires, au moins les envieux dissimulaient-ils leur envie, parce que François
était ce qu'on est convenu d'appeler un « bon garçon ».
Etre « bon garçon », c'est-à-dire n'avoir
point d'opinion à soi, mais adopter l'opinion de tous, être de l'avis du dernier
qui parle, avoir volontiers la main au gousset quand il s'agit de s'amuser et
d'amuser les autres. En somme, la bonté du bon garçon est souvent synonyme de
faiblesse ; ce qui devrait être une qualité devient un défaut qui peut avoir
parfois de funestes conséquences. Malheureusement, la meunière était un peu
comme son mari ; très bonne et très douce, elle subissait son influence. Si le
meunier était bon garçon, la meunière était brave femme, au sens strict du
mot, s'occupant activement de son ménage, soignant affectueusement son mari et
son fils, veillant à sa basse-cour et à l'ordre intérieur, mais incapable de
réagir et de montrer de la fermeté si une circonstance grave s'était présentée.
Quoi qu'il en fût, les Berluchot vivaient
heureux dans leur moulin! - Pour eux, le Mesvrin et les hameaux environnants
constituaient la plus belle partie de l'univers.
Le moulin du Mesvrin était joliment campé au bord du large étang dont
il empruntait les eaux après lui avoir emprunté son nom : « Mesvrin», que l'étang
lui-même tient de la rivière qui l'alimente en partie. Cette rivière coupe en
deux la contrée encaissée dans les vallonnements des collines morvandelles. Le
Mesvrin est un joli cours d'eau sous-affluent de la Loire, par l'Arroux.
Peu profonde, point large, la petite rivière, que la plupart du temps on pourrait traverser à gué, roule ses eaux tranquilles sur un lit pierreux cher aux écrevisses (aux « greuches », comme on dit dans le pays). Les bords sont gais et riants, plantés d'aulnes et de saules dont les pieds perdent dans un fouillis de plantes folles aux ombelles crémeuses ou rosées, aux corolles dorées ou nacrées. De-ci là, quelques peupliers droits, rigides, dominent le tout ; comme de hautes sentinelles ils semblent veiller sur le pays et garder les « laveuses », qui y viennent en groupe bavarder en lessivant leur linge, le frappant de leurs battoirs dont les flac-flac résonnent au loin.
La route qui serpente en descendant du moulin
inégale ; de larges escarres produites par des éboulements de talus dans la
rivière l'échancrent de place en place. Tout le long s'échelonnent de petits
hameaux aux jolis noms : Les Verniseaux, la Navière, le Bas-de-Marcet,
Bouvrier-de-Boyi, les Sourdeaux, la Bessotte, les Lamours, etc.
Leurs maisons, sur lesquelles courent capricieusement des vignes dont les vrilles s'accrochent à toutes les aspérités, sont pittoresques et amusantes à voir avec leurs petites barrières de bois, leurs escaliers extérieurs, leurs appentis, étables ou fours à pain. Elles s'adossent à la colline en haut de laquelle sont d'autres villages encore.

Les habitants appellent pompeusement « la
Montagne » cette colline encombrée de « balais » (ainsi nomment-ils les genêts)
et de bruyères qui poussent dru en ce terrain aride tout boursouflé de rochers
couverts de mousses et de lichens.
Toute la contrée a été remuée autrefois par
des bouleversements souterrains, et les oscillations qu'elle a subies ont
ouvert un peu partout des crevasses et des ravins. Quand on est sur la hauteur
et qu'on jette un regard sur la région, on aperçoit une suite d'ondulations
ressemblant assez à une mer agitée qu'une force brutale aurait solidifiée.
CHAPITRE III
L'ENFANT TROUVÉ

Dès qu'il fut dans la cour du moulin, André
se dirigea rapidement vers l'escalier conduisant à sa demeure. Il repoussa les
deux chiens qui accouraient vers lui en
gambadant et lui sautaient dessus, réclamant la caresse habituelle : «
Allons, paix Tom !... couché Finot !... »
Les pauvres bêtes s'en allaient, penaudes,
les yeux tristes, se retournant de temps à autre vers leur jeune maître, le
regardant piteusement, ayant l'air de lui demander ce que signifiaient ces
nouvelles façons. Et les moutards qui lui faisaient fête quand il rentrait,
restaient tout interloqués, les yeux ronds, ne comprenant rien à son indifférence, car il était passé
sans leur dire un mot, lui qui d'habitude s'arrêtait volontiers pour jouer un
instant avec eux ou distribuer « à ceux qui avaient été sages » quelques bonbons
ou quelques billes.
Au dîner, le meunier et sa femme remarquèrent
son air pensif.
- « Mais quoiqu't'aidonc, garçon? »
Evasivement il répondit qu'il n'avait rien,
qu'il se sentait un peu fatigué, voilà tout.
La nuit il dormit mal.
Les images entrevues lui dansaient devant les
yeux mais, comme tantôt, restaient imprécises. Au moment où il lui semble qu'il
va enfin les saisir nettement, elles disparaissent pour surgir derechef, mais toujours
embrumées, incolores, informes.
Et le matin en retournant à l'école, et tout
le long de la route de Saint-Sernin, ces mêmes pensées le hantèrent.
Il fut distrait ce jour-là.
L'instituteur, habitué à le voir studieux,
s'étonne de son inattention... C'est la première fois qu'on doit le rappeler à
l'ordre. Mais il a beau faire, c'est ici surtout que ses idées lui reviennent
avec le plus de force.
Derrière lui, sur un banc, isolé, en
punition, sourit hypocritement le petit garnement cause de toutes ses
préoccupations.
- «... Enfant trouvé, enfant trouvé! » se
répète sans cesse André.
De grand coeur, quoique bon et généreux, il
étranglerait celui qui est cause de ses souffrances, car il souffre, le pauvre
garçon, il souffre de l'incertitude, du vague où il est plongé depuis hier.
Cette incertitude, à tout prix, il faut qu'il en sorte.
Déjà hier soir, lorsque ses parents
s'inquiétaient de son air pensif, il avait été sur le point de tout leur dire ;
la crainte de mécontenter son père, mais surtout la peur de blesser ou
chagriner sa mère pour laquelle il a grand respect et profonde affection,
l'avaient empêché de parler. Mais, en retournant chez lui après la classe, il
décide que le soir même il aura un entretien avec sa mère. Il usera des plus
grands égards, s'excusera à l'avance de la peine que peut-être il pourra
causer, mais il faut qu'il sache. Il sent qu'il ne pourra supporter cette
incertitude.

Au moment du repas, son père étant présent,
il fit de son mieux pour paraître dans son état habituel, mais dès que le
meunier fut retourné à sa besogne il raconta à sa mère la querelle et la façon
dont elle s'était terminée, puis il lui dit doucement ; - « pardonne-moi,
maman, si je te cause de la peine, mais depuis hier ces vilains mots me
résonnent aux oreilles, je te demande en grâce de me dire ce qu'ils signifient.
»
La meunière se mit à fondre en larmes.
- « J'aurais dû, mon André, te dire la vérité
tôt ou tard.
Je reculais toujours le moment afin d'avoir
plus longtemps devant moi pour acquérir ton affection.
- « Mère! c'est mal ce que tu dis là. Tu sais
bien mon affection pour toi est sans bornes. Je t'aime de tout mon coeur, et
quoi que tu m'apprennes, tu es et tu resteras ma bonne, ma chère maman.
- « Merci, mon enfant. Maintenant je vais
tout te dire, tiens ! pour être bien sûre de n'omettre aucun détail et te bien
narrer toutes les circonstances, nous allons faire venir la Nanette, car c'est
à elle que tu dois, mon cher petit, d'être encore de ce monde; c'est elle qui
t'a trouvé et t'a amené à moi, ne pouvant, vieille, infirme et pauvre, t'élever
elle-même. »
Lorsque la Nanette fut là, les deux femmes
fermèrent les portes et, assises sous le manteau de la cheminée, tandis
qu'André appuyé sur la table les regardait avidement, elles lui racontèrent son
histoire.
Voici ce qui s'était passé :
y
avait de cela un peu plus de dix ans. Un matin que François Berluchot allait
visiter la vanne de son moulin il aperçut la Nanette à moitié enfouie dans les
hautes herbes bordant la rivière. L'interpellant en langage familier :
- « Quoi donc que t'fais dans les roseaux, la
Nanette, t'as donc égaré un ouyeau? (oiseau).
- « S'agit ben d'mes ouyeaux; En v'là eune
affaire !! Tins ! r'gardes-y putôt!... »
Et la Nanette sortit de la rivière portant
dans ses bras un bébé tout couvert de vase, trempé, grelottant, respirant à
peine.

- « En v'là eune trouvaille!... » s'écria le
meunier, et il examina l'enfant qu'il ne reconnut pas pour être du pays.
- « On y voiré plus tard, interrompit la
Nanette, pour l'instant faut porter le p'tiot au moulin et l'réchauffer tout de
suite, o lo aux troés quarts mort. Tins ! prends l'donc té qu'est valide... »
Et elle mit le marmot dans les bras du meunier qui courut au moulin à grandes
enjambées, suivi de la Nanette, tout émotionnée de l'aventure et faisant de son
mieux pour le rattraper.
- « Tiens, la meunière, dit François en
posant son fardeau entre les bras de sa femme, j't'apporte un cadeau seul'ment
faut l'mettre au chaud car y'n'vaut pus guère, pauv'petiot! »
La meunière, surprise comme on pense en
voyant de quelle nature était le cadeau, s'informa.
La Nanette entrait en ce moment et raconta
comment en arrivant vers la rivière elle avait voulu, avec son bâton, chasser
une de ses oies qui s'obstinait à vouloir aller à l'eau alors qu'elle avait
décidé de la mener au pré voisin avec ses compagnes. Elle avait, en
s'approchant du bord, entendu des plaintes. Croyant qu'un jeune chien ou un
jeune chat s'était pris dans les herbes et n'aimant pas plus voir souffrir les
animaux que les gens, elle était entrée dans les roseaux pour le tirer de sa
fâcheuse posture.
- « Vous pensin ben si j'éto étonnée
on trouvant là un p'tiot au lieu d'eune bête ; ol étot pris dans les herbes et
y s'cramponnot tant qu'o pouvot... »
Les enfants qui jouaient dans lu cour avaient
vu entrer le meunier et l'avaient suivi jusque chez lui ; l'un d'eux courut
conter l'aventure à sa mère qui arriva la bouche pleine, tenant d'une main son
couteau et de l'autre son pain sur lequel elle maintenait avec son pouce un
gros morceau de fromage. Puis d'autres voisines accoururent et bientôt la
maison du meunier fut pleine de commères donnant leur avis, leurs
appréciations, ahurissant un peu la pauvre meunière qui, n'ayant jamais eu
d'enfants à soigner, était bien un peu embarrassée de celui-ci.
Une des voisines compatissantes déshabilla le
marmot, puis l'entortilla dans des couvertures. Une autre fit une flambée dans
la cheminée, une troisième chauffa du lait chaud, on le frictionna, puis enfin
réchauffé, on le glissa dans le lit, on l'enfouit sous l'édredon.
A ce moment survint un des garçons meuniers.

En allant à la vanne il avait, dit-il, trouvé
brisé la « pianche » qui traverse le pré près d'la bouchure et le talus
« déberdoulé ».
«
Allons voir ça. Viens nous deux, garçon! » répondit le meunier .
Et les deux hommes allèrent vers la rivière.
En effet, la planche vermoulue qui servait de
passerelle s'était brisée sous une pression quelconque et s'était drée dans la
rivière, entraînant une partie du talus. Comme le meunier s'avançait pour
examiner de plus près le dommage, il poussa un cri... Derrière le talus et
cachée par les terres et les herbes, une femme était couchée la figure dans
l'eau.
François l'appela, la secoua, elle ne bougea
pas.
- « Allons, hardi garçon, portons c'te
pauv'femme au moulin... En v'là des aventures! »
Lorsqu'entra le cortège ce fut, parmi les
gens du moulin, un effarement inouï.
On coucha la femme, on tâcha de la
réchauffer, mais rien ne la fit revenir à elle et lorsque le médecin, qu'un
moutard avait couru chercher au Creusot, arriva, il ne put que déclarer que la
malheureuse était morte.
Il fallait maintenant prévenir le garde
champêtre, le maire, les autorités qui vinrent au moulin faire les
constatations d'usage.
Évidemment la découverte de cette femme et la
trouvaille de l'enfant avaient pour point de départ le même drame qu'un
minutieux examen reconstitua.
La femme et l'enfant avaient dû ensemble
traverser la planche qui n'était pas un passage public mais servait seulement
au meunier et à ses garçons. Or, cette planche avait cédé, entraînant les deux
voyageurs; l'enfant avait été heureusement arrêté dans les hautes herbes mais
la femme, assez grande et robuste, était tombée à l'eau en se heurtant
fortement aux pierres du fond ; la secousse l'avait étourdie, elle était restée
là au froid et avait succombé à une congestion.
Elle n'avait sur elle aucun papier qui pût la
faire reconnaître. Vêtue simplement, son aspect l'indiquait de condition
ordinaire.
L'enfant, au contraire, avait des vêtements
de coupe élégante et du linge fin.

En le déshabillant, on avait trouvé, attachée
à son cou par une chaînette d'or fermée par une agrafe piquée de turquoises,
une médaille d'or portant sur la face une croix de Saint-André sur fond
finement ciselé et au revers ces mots gravés :
ANDRÉ
2 Juillet 1880.
Baltimore.
(U. S.)
Une aventure du genre de celle qui avait eu
le moulin pour théâtre met en émoi toute une contrée. Aussi vint-on d'un peu
partout aux informations. Chacun voulait voir et satisfaire sa curiosité.
Parmi les visiteurs plusieurs reconnurent la
morte pour une femme d'Anthully (village des environs) nommée Marie Louise.
Elle avait quitté le pays environ trois ans auparavant pour se placer comme
bonne à Paris. Au début elle a donné de ses nouvelles, puis on n'avait plus
entendu parler d'elle qu'à de longs intervalles ; on savait seulement
que sa dernière lettre, datée de longtemps déjà, annonçait qu'elle partait
avec ses maîtres « dans des pays étrangers».
Quant à l'enfant, on ignorait qui il était,
d'où il venait.
Seule, l'inscription de la médaille donnait
de vagues indices : Il s'appelait André, il l'avait confirmé par la suite ;
lorsqu'on lui avait demandé son nom il avait répondu : « Andé Oulan». « Andé »
se traduisait facilement par André, mais de « Oulan », nom de famille
évidemment, il était difficile, sinon impossible, de reconstituer l'appellation
réelle.
Baltimore était vraisemblablement le lieu de
naissance et 2 juillet 1880, la date.
L'enfant avait donc deux ans environ. Il
était charmant avec ses grands yeux bleus et ses longues boucles blondes.
Les premiers jours il ne cessa de réclamer,
en pleurant, «sa nounou»…. Sa nounou était sans nul doute la pauvre femme
trouvée au bord de la rivière. Puis il appela : « papa, maman! » cela en
sanglotant. On fit de son mieux pour le consoler.
L'enfant a le bonheur de vite oublier ses
chagrins ; comme il ne raisonne pas, il ne ressent que les peines immédiates,
il les ressent vivement c'est vrai, mais point longtemps.
Peu à peu le petit bonhomme se calma,
commença à gazouiller et s'habitua aux nouvelles figures qui l'entouraient. Les
moutards habitant le moulin venaient le considérer de leurs grands yeux étonnés
; il leur souriait, leur tendant ses petits bras.
Il y avait six jours seulement que le petit bonhomme avait été trouvé et déjà il se sentait chez lui, il avait pris possession de son nouveau domicile.

De son côté la meunière, qui malgré son
désir, n'avait pas la joie de posséder d'enfants, s'était déjà attachée au joli
poupon qui était venu échouer au moulin.
Un soir qu'elle le tenait sur ses genoux, lui
donnant la becquée au moyen d' une grande cuiller vers laquelle il avançait
goulûment sa petite bouche, François lui dit en rentrant pour dîner :
- « T'as vraiment l'air d'une petite maman
comme ça, on croirait que t'as nourri déjà des tas de mioches... Mais, quoi
qu'on va en faire de ce p'tiot-là ?
- « Oh ! François, si tu voulais on
l'garderait ; puisque j'en ai point, on élèverait celui-ci tout comme s'il
était à nous !... Veux-tu ? J'serais si heureuse!
- « Ben oui ! Ben oui ! » répondit le brave
homme qui lui aussi s'était si bien attaché à l'enfant que plusieurs fois par
jour il quittait ses meules pour venir le regarder, lui chatouiller le menton,
ce qui faisait rire le moutard de toutes ses forces. « Ben oui ! mais il n'est
pas à nous, et j'sais pas trop si c'est permis de le garder comme ça... et
puis, si un jour on vient l'réclamer... Comment qu'on ferait?
- « Dame ! j'sais point non plus, moi.
Faudrait s'informer et d'mander à l'instituteur. Il est savant lui, il nous
dira comment qu'y faut faire... Alors, François, si y a point d'empêchement tu
veux bien qu'on l'garde ?
- « Ben sûr ! »
Et l'apprentie maman courut embrasser son
mari en le remerciant.
François consulta l'instituteur et sut par
lui la marche à suivre, peu compliquée du reste : une simple déclaration devant
le maire et contresignée par deux témoins suffit. Il fut pourtant fait une
restriction : Si les parents étaient retrouvés un jour et venaient réclamer
l'enfant, ils devraient le leur rendre, quittes à se faire rembourser les frais
d'entretien.
L'enfant resta donc au moulin, choyé, dorloté
par ses parents adoptifs qui l'aimaient comme s'il eût vraiment été leur fils.
De son côté le petit, tout à fait habitué à sa nouvelle existence, considérait
le meunier et sa femme comme ses parents ; l'image des autres s'était, dans son
petit cerveau, totalement effacée.
Quand il fut en âge, on le conduisit à
l'école ; la route étant longue, la meunière le conduisait tous les matins,
allait le chercher tous les soirs.
Lorsque l'enfant se fut accoutumé, elle le laissa aller en compagnie des autres enfants du pays, qui avaient du reste pour leur nouveau petit ami tous les soins imaginables et lui témoignaient certains égards, car il portait en lui un charme qu'ils ne s'expliquaient pas, mais dont tous subissaient l'influence. Pourquoi ? ils n'en savaient rien, les manières de l'enfant étaient tout autres que celles de ses camarades, son parler tout différent aussi.

Il se montrait doux et bon avec tous ses
petits compagnons qui l'adoraient.
Remarquablement intelligent, il fut bientôt
le premier de sa classe, il apprenait vite et facilement et, ce qui vaut mieux,
retenait les choses apprises.
On était donc heureux au moulin où André
rentrait toujours joyeux...
- « Enfin ! dit la meunière en embrasant son
fils quand elle eut terminé son récit, enfin, mon André, tu ne m'as donné que
des satisfactions et il me semble bien que tu es à moi, à moi seule. »
Puis, se levant, elle monta dans sa chambre
chercher dans un meuble, dont la clef ne la quittait jamais, une petite boîte
qu'elle remit à André :
- « Tiens, mon fils, il y a là-dedans le
collier avec sa médaille. Remets-le à ton cou et qu'il ne te quitte plus.
Peut-être bien qu'un jour il te fera retrouver tes parents ; ce serait bien
heureux pour eux, mais bien triste pour moi, car tu devrais me quitter et je
n'aurais pas la force de me séparer de toi sans en mourir de chagrin. »
André sauta au cou de la meunière :
- « Sois tranquille maman, ma chère « maman »
, dit André en appuyant sur cette appellation, quoi qu'il arrive, tu es et tu
resteras ma mère et si celle qui m'a mis au monde revient, eh bien! j'aurai
deux mères au lieu d'une et j'aimerai l'une autant que l'autre. »
A partir de ce moment André fut plus calme.
De temps à autre il se prenait bien à rêver
un peu...
Comment s'appelait-il ?.. Qu'étaient sa mère,
son père ?.. Où pouvaient-ils être ?... Vivaient-ils encore ?... Autant de
points d'interrogation qu'il se posait parfois, mais dont il ne pouvait trouver
la solution... La trouverait-il jamais ? Saurait-il jamais d'où il venait,
comment, par suite de quelles circonstances il se trouvait en ce pays ?..
Jusqu'ici il s'était bel et bien cru fils de
meunier, destiné, à être meunier un jour, lui aussi, et il avait travaillé
sérieusement, s'intéressant à tout ce qui plus tard pourrait lui servir pour
son métier.
Maintenant, la confidence que lui avait faite
sa mère bouleversait toutes ses pensées !...
Il s'efforçait pourtant de les chasser au
plus vite, car il les jugeait peu généreuses pour ses parents adoptifs aussi
bons, aussi dévoués, aussi tendres pour lui que s'il avait été réellement leur
enfant.
Ces pensées, qui par sa volonté n'étaient que
passagères, n'eurent aussi aucune influence sur son caractère ni sur sa façon
d'être ; elles n'entamèrent en rien la profonde affection qu'il avait pour ses
parents, peut-être même, à partir de ce moment, fut-il plus tendre encore
vis-à-vis de sa mère.
CHAPITRE IV
PROMENADES AUX CHAMPS ET A LA VILLE
Tout marchait donc pour le mieux au moulin du
Mesvrin. Les affaires étaient prospères, la santé florissante. François
Berluchot faisait de temps à autre des tournées aux environs pour aller voir
ses clients ; sa femme redoutait un peu ces sorties et préférait les voir faire
par les garçons meuniers, car ces jours-là le meunier rentrait généralement
assez tard et quelquefois un peu... gai, les tournées à la campagne se
compliquant de tournées dans les auberges. Non pas que François fût un buveur,
mais il avait le tort d'offrir ou d'accepter trop facilement de « trinquer».
Il appelait cela « conclure une affaire ».
- « Quand on a trinqué, disait-il, on peut plus se dédire, c'est comme si tous les notaires du pays y avaient passé ! » C'était là le seul nuage qui chagrinât la meunière car, en dehors de ces sorties assez espacées, du reste, François s'occupait activement de son travail qui était toujours fait en temps et heure.
Souvent le soir, des amis venaient passer
quelques moments au moulin ; l'hiver, on y faisait parfois la veillée. Le frère
cadet de la meunière, « le Louis », meunier dans une commune voisine, profitait
des visites que de son côté il faisait à ses clients pour venir dîner ou
déjeuner de temps en temps au moulin avec son beau-frère, sa soeur et « son
neveu » ; car lui aussi considérait André comme l'enfant de sa soeur et il
aurait mal reçu celui qui lui eût contesté cette parenté avec un neveu qu'il
aimait, dont il appréciait les qualités. André lui rendait du reste toute son affection.

De plus en plus, André oubliait ses
préoccupations de naguère, et si parfois il se demandait « qui il était », vite
il chassait ces pensées en se répondant : « -Et après tout, qu'importe, je suis
heureux tel que je suis, qui sait si j'eusse été heureux autrement !... » Et sa
gaieté lui revenait aussitôt.
Travaillant bien et sans relâche pendant la
semaine, il entendait se promener le dimanche.
Et chaque dimanche on allait, soit aux
environs dans les bois de Saint-Sernin ou aux hameaux « sur la montagne », soit
en excursions lointaines ; alors on attelait la carriole, on emportait des
provisions et, l'heure du déjeuner venue, on s'installait sous les arbres
séculaires, superbes et touffus du bois d'Autun, puis on parcourait la ville.
André adorait ces promenades ; qu'on allât à la ville ou dans les bois, qu'on se rendît chez les amis des hameaux voisins ou dans les fermes des environs, il se montrait également joyeux.
Si son esprit avide d'apprendre s'intéressait
aux choses sérieuses, sa bonne humeur le portait à gambader à travers vallons
et bois, à rire avec ses compagnons.
La première fois qu'il alla à Autun, il tomba
en arrêt devant les vieux monuments que conserve la ville.
Dans les bouquins que lui avait prêtés
l'instituteur il avait lu l'histoire d'Autun, il savait pour quelles
fluctuations avait passé la célèbre cité d'Auguste, la ville aux mille temples.
Aussi resta-t-il longtemps à considérer ces souvenirs des siècles passés,
antiques débris, qui furent témoins de tant de choses ! - La porte d' Arroux,
la porte de Saint-André - son patron - sous les arcades de laquelle avaient
circulé les légions romaines, le temple de Janus, d'autres monuments encore le
tinrent longtemps arrêté. Il eût voulu
en apprendre davantage à leur égard.
Il s'enquit auprès du meunier, mais celui-ci
dut avouer son ignorance : « Vois-tu, mon p'tiot, de mon temps on n'apprenait
pas ce qu'on apprend maintenant, et dame, toutes ces vieilles constructions-là,
je sais que ça date de longtemps, mais je n'sais pas au juste de quand... Ça,
ton instituteur te le dira. »
Le lundi, généralement, l'instituteur était
certain, au moment des récréations, de voir André venir à lui et l'interroger
sur ce qu'il avait vu la veille.
Parfois c'étaient tout uniment des
renseignements sur telle ou telle plante dont il rapportait un échantillon, sur
tel ou tel arbre qu'il décrivait de son mieux...

- « Ah ! nous sommes allés dans les bois
hier, lui disait l'instituteur, il s'agit de botanique, aujourd'hui. »
Quand André venait vers lui et lui disait : «
Je suis allé dans la ville de..
- « Bon ! interrompait l'instituteur, il va
falloir rassembler mes souvenirs historiques et archéologiques... Voyons, nous
sommes allés... où ça ?... »
Et André racontait sa promenade, disait ce
qu'il avait vu, donnait ses impressions, puis enfin questionnait sans relâche.
Il sut ainsi à quoi s'en tenir sur tous les
monuments vus dans les environs. Il apprit l'histoire des ruines de Champitaux
dont le donjon carré se reflète dans le grand étang qu'il domine de ses murailles
décrépites ; il sut qu'elles furent plantées là par les seigneurs d'Antully au
XIV siècle et durent subir jadis le choc des armées anglaises.
Il eut tous les détails désirables sur le vieux château des Montaigut qui, dans le pays des vignes, domine la charmante localité qui a nom : Couches-les-Mines. Château fort curieux du reste et dont il subsiste d'imposants vestiges. On avait dit à André que ce château fut jadis la demeure de Marguerite de Bourgogne et on lui avait fait voir les oubliettes où celle-ci faisait disparaître ceux qui avaient cessé de lui plaire.


- « Mon garçon, lui dit l'instituteur,
il faut, en général, vous méfier de tous ces racontars ; un peu en tous pays,
il existe des châteaux ayant appartenu à des personnages célèbres ; Marguerite
de Bourgogne, notamment, a des châteaux dans tous les coins.
« Et je me demande vraiment comment, à une
époque où les routes étaient si mauvaises et les moyens de locomotion si
peu rapides, ces gens-là faisaient pour habiter presque en même temps des
domaines aux quatre points cardinaux de la France ?.. Et que de légendes où les
oubliettes jouent un rôle marqué ! C'est sombre, c'est mystérieux, c'est
horrible, bonnes raisons pour que cela attire, intéresse, émotionne.
Et l'on est enclin alors à croire tout ce que
vous narre le cicérone qui vous fait visiter... En général, c'est aux trois
quarts faux, mais, comme il est souvent difficile de le prouver, on laisse dire
et parfois on se laisse persuader.
« Méfiez-vous de tous ces racontars
soi-disant véridiques et, quand vous voudrez savoir, basez-vous sur l'Histoire,
la vraie et non celle accommodée par Alexandre Dumas père qui la connaissait,
lui, mais, plein de désinvolture charmante, jonglait avec les faits et les dates
suivant les besoins de « sa » cause.
« Et tenez ! Il me souvient que lors d'un
voyage en Auvergne on me fit visiter les ruines d'un important château ; lui
aussi, prétendait mon guide, avait appartenu à Marguerite de Bourgogne et
possédait également les fameuses oubliettes qui avaient servi à un identique
usage... Or, le château datait du XVe siècle et la femme de Louis le Hutin
périt, étouffée, au commencement du XIVe… Concluez! »
Les conversations d'André et de son maître
d'école les intéressaient tous deux ; André était un auditeur attentif, le
maître d'école, modeste instituteur de campagne, cachait sous une enveloppe un
peu lourdaude, beaucoup de bon sens et pas mal d'érudition.

CHAPITRE V
LES SUITES D'UN HÉRITAGE
Parmi les voisins du meunier, l'un des plus
assidus dans ses visites était le père Thomas. Point méchant, mais ivrogne
comme Silène, il passait plus de temps à boire qu'à travailler ; aussi le
voyait-on plus souvent gris que de sang-froid.
Il déplaisait fortement à la meunière et
André le détestait, mais il amusait le meunier par ses réflexions drôles et ses
réparties inattendues.
Très habile dans son métier de chanvrier,
Thomas était un des derniers à l'exploiter, car les machines remplacent de nos
jours le travail de l'artisan.
Néanmoins il avait de la besogne et lorsqu'il
se mettait à l'oeuvre, le père Thomas rouissait le chanvre comme pas un et
nulle machine n'aurait mieux que lui broyé et teillé les
filaments de la souple plante.
Mais dès qu'il avait empoché son salaire, il
lâchait la broie et s'en allait d'auberges en cabarets, en quête de ses
deux grands amis : le Chochet et le père Chandel, aussi ivrognes, aussi
flâneurs que lui. Le premier, petit, l'air renfrogné, vrai type d'abruti ; le
second, long diable sec, riant sans cesse d'un air idiot. Les membres de ce
joli trio se réunissaient pour faire force parties de cartes ou de billard,
mais surtout pour vider force flacons.
Qu'ils maniassent les cartes gluantes et
graisseuses ou s'escrimassent à faire rouler sur le tapis décoloré, plein de
reprises et de crasse, les billes du billard, l'enjeu était toujours le même :
une bouteille. Aussi, que de parties, que de bouteilles !!!

Et l'on ne quittait la place que quand
l'heure de la fermeture sonnait ou lorsque l'escarcelle était à sec
l'aubergiste alors renvoyait ses clients.
Invariablement gris à eux trois comme toute
la Pologne, ils regagnaient leurs taudis tant bien que mal, titubant à qui
mieux mieux.
Chochet et Chandel habitaient du côté de la rivière où se trouvait
l'auberge. Thomas les accompagnait ordinairement jusqu'à leurs portes puis s'en
retournait seul en chantant à tue-tête, et abominablement faux, de vieux
refrains locaux :
« Tote la nuit a riboulot
T'y v'la, t'y v'la, t'y v'la pris
Tote la nuit a riboulot
T'y v'la pris dans l'trébuchot! »
Une chose pourtant inquiétait fortement notre
buveur : la traversée de la rivière ! Tout ivre qu'il' était, il se rendait
compte qu'il ne marchait pas droit (bien qu'il prétendît que c'était la route qui
« croûlait »), et il savait fort bien que la planche servant de pont était
étroite et aux trois quarts pourrie ; aussi se calmait-il au fur et à mesure
qu'il approchait.
C'est qu'un soir il était bel et bien tombé à
l'eau et, incapable de se dépêtrer tout seul, il y serait carrément resté si le
dieu des ivrognes, veillant sur lui, ne lui avait envoyé un sauveur sous la
figure d'un paysan qui s'était attardé au village voisin et l'avait repêché.
De ce jour, la rivière lui causait une folle
terreur ; aussi, avant de la traverser, hésitait-il longtemps et ne se
risquait-il sur la passerelle qu'après avoir fait une invocation :
- « Saint Thomas, disait-il d'un ton ému, mon
vieux saint Thomas, mon bon patron, j'te promets qu'si te m'fais passer sans
tomber à l'eau, j'boirons pus, j'boirons pus jamais!... »
A quatre pattes alors, presque rampant sur le
ventre, s'agrippant de son mieux en serrant la planche dans ses bras, il
faisait sa traversée en tremblant. Mais sitôt de l'autre côté il se relevait
tant bien que mal, se retournait joyeux et criait à tue-tête :
- « J'boirons cor, j'boirons cor !... attrapé
l'saint Thomas ! »
Et dès le lendemain il tenait sa promesse, la
seconde, s'entend.
 Tout
le monde dans le pays connaissait la passion du père Thomas ; si certains le
blâmaient, le grondaient même, d'autres avaient la mauvaise idée de lui «
offrir un verre » sous prétexte qu'après il était « ben drôle ».
Tout
le monde dans le pays connaissait la passion du père Thomas ; si certains le
blâmaient, le grondaient même, d'autres avaient la mauvaise idée de lui «
offrir un verre » sous prétexte qu'après il était « ben drôle ».
Le meunier était du nombre et quand Thomas venait le voir, il ne manquait pas de le faire boire, malgré les remontrances de sa femme qui eût même voulu que François l'empêchât de venir : - «Bast ! » disait le meunier, y a pas grand mal à ça et pis y m'amuse quand il « est bu ! ».
Un jour que Thomas, point encore tout à fait
ivre mais en passe de l'être, entrait au moulin où il comptait bien s'achever,
il en trouva les habitants tout joyeux.
Le meunier, en grande toilette, revenait de
chez un notaire d'Autun où il avait été mandé « pour une affaire le concernant
».
Il s'y était rendu non sans quelque
inquiétude car les campagnards se méfient de tout ce qui, de près ou de loin,
touche à la magistrature.
- « Pourvu qu'ça soit pas pour quéque
méchante affaire », dit-il en partant.
Aussi l'attendait-on au moulin avec quelque
anxiété, mais dès qu'on l'aperçut, on devina qu'il était porteur d'une bonne
nouvelle ; il arrivait en courant, la figure animée, le chapeau en arrière,
l'air victorieux.
Le notaire lui avait annoncé qu'il héritait
de tout le bien d'un parent, un oncle qui venait de mourir sans crier gare.

Les Berluchot ne le voyaient guère, cet
oncle, sorte de vieil ours mal léché qui bougonnait quand on lui rendait
visite, souvent ne recevait pas du tout ou flanquait les gens à la porte quand
il les avait reçus. Il se figurait toujours qu'on voulait le dépouiller de ses
« pauv' nippes » ou qu'on venait manger « sa marande », lui « qu'avait autant
dire rin de rin ! »
On le croyait donc pauvre, mais le vieux
thésaurisait et laissait bel et bien à son neveu, son seul héritier direct, -
cela bien à contre-coeur sans doute, mais la camarde ne lui avait pas demandé
son heure - quelques bons lopins de terre au pays des vignes, une maison
convenable et un bas de laine contenant quelques milliers de francs en beaux
écus sonnants.
Et c'était là la cause, assez justifiée avouons-le,
de la gaieté qui régnait au moulin ce soir-là.
- « Bon sang de bon soir! dit le père Thomas
en lançant son chapeau en l'air, en v'la eune bonne nouvelle !... Bravo,
François, t'paieras ben quéques tournées à la santé de l'oncle!... ça vaut ça,
pas vrai ?.. »
La meunière jeta à Thomas un regard furieux.
André, n'osant rien dire, se contentait de hausser les épaules avec dégoût ;
quant au meunier, un peu en train déjà et tout heureux de sa bonne aubaine, il
acquiesça par ces simples mots : «Tout d'même, mon vieux Thomas! » Et les deux
hommes sortirent. François ne rentra pour dîner que fort tard ; il dîna seul,
car sa femme, fatiguée de l'attendre, s'était mise à table avec André et avait
fini depuis longtemps.

Le lendemain, rentrant de l'école, André
arrivait à la porte du moulin presque en même temps que Thomas qui se disposait
à y entrer. Se doutant bien qu'il venait pour entraîner encore le meunier, il
prit le parti de lui dire :
- « Vous venez pour voir mon père ?... Inutile
d'entrer ; il est absent et rentrera tard.
- « Bah! j'l'ons aperçu y a pas une heure
!...
- « Possible, mais depuis il est sorti. »
André avait pris sur lui de faire ce
mensonge, excusable pour son intention, et se promettait bien d'en user le plus
souvent qu'il pourrait pour écarter Thomas. Celui-ci crut ou ne crut pas ce que
lui disait le jeune homme, mais il n'insista pas et s'en retourna en maugréant
:
- « Dommage ! j'voulains lui causer, ça serai
pour eune aut'fois! »
Et le lendemain - il revint à la charge,
mais, se méfiant d'André dont il sentait l'antipathie, il vint avant que
celui-ci ne rentrât de l'école et fila directement au moulin où il trouva le
meunier en train de vider lui-même du grain dans les meules.
Il s'assit, regarda faire, puis s'écria :
- « Dis donc, l'François, si j'étais à ta
place avec des sous plein ma tire-lire, j'prendrais point tant d'mal que toi! »
François se retourna, ne dit mot et continua
sa besogne. Mais Thomas insista; il connaissait le caractère faible et un peu
naïf du meunier ; il sentait que celui-ci, encore sous l'impression de
l'héritage qu'il venait de faire ; ne regarderait pas à la dépense « pour
s'amuser » ; or, s'amuser, pour l'ivrogne, c'était boire, boire, encore boire.
Thomas avait deviné juste. Lorsque le meunier eut vidé ses sacs il appela ses garçons, leur passa la surveillance du travail, donna quelques ordres et partit bras dessus bras dessous avec son camarade.
Les vilaines habitudes sont celles qui se
prennent le plus rapidement et les pernicieux conseils ceux qu'on suit avec le
plus de facilité.
Thomas finit par entraîner régulièrement le
meunier à l'auberge; ce fut d'abord vers la fin de la journée, sous prétexte
d'apéritifs, puis il vint un peu plus tôt quérir son ami François.
Le Chochet et le père Chandel, les deux
piliers d'auberge dont Thomas avait fait ses compagnons habituels, devinrent
bientôt les compagnons du meunier. Comme Thomas, ils n'avaient pas manqué de
lui dire combien il avait tort, maintenant qu'il venait d'hériter, de se donner
du mal à travailler sans relâche.
-
« V'la
des années qu 'tu trimes, t'as ben gagné de t'donner un peu d'bon temps !... »
-

Et François se disait qu'après tout ses
camarades avaient raison.
Un soir qu'il rentrait passablement gris, la
meunière, désolée du changement de conduite et de l'entraînement que subissait
son mari, lui fit doucement quelques reproches.
Généralement le meunier écoutait les avis de
sa femme qu'il sentait supérieure à lui, mais cette fois, sous l'empire de la
boisson, il lui répondit qu'il était libre de faire ce qu'il voulait, qu'il
était le maître et qu'après tout c'était son argent qu'il dépensait puisque
c'était lui qui avait hérité.
La meunière fondit en larmes.
Un peu penaud, François alla se coucher et le
lendemain, dégrisé, de sang-froid, il demanda à sa femme d'oublier ses mauvais
propos de la veille.
Pendant deux jours tout se passa bien, le
meunier ne sortit pas et sa femme s'en montrait toute joyeuse déjà, espérant
qu'il allait reprendre ses habitudes régulières d'autrefois.
Hélas! la pauvre femme comptait sans le
mauvais génie qui n'avait garde de lâcher pied si aisément.
Comme pendant deux jours il avait été évincé
par François, Thomas attendit celui-ci aux alentours du moulin. Le meunier
avait toujours à sortir de temps à autre, soit pour régler la vanne, soit pour
quelque autre soin à prendre.
Thomas alla vers lui dès qu'il l'aperçut et
fit si bien qu'il l'emmena soi-disant pour quelques instants... François rentra
quand on ferma l'auberge.
Le meunier avait fait deux jours d'abstinence
; l'envie de boire lui revint plus forte et puis il s'était, comme les autres,
adonné au jeu de cartes et au billard, et ne pas jouer le privait.
Thomas avait su le prendre par un imbécile
amour propre, le laissant gagner au jeu (il n'y risquait pas grand' chose, du
reste, car qu'il gagnât ou perdît, c'était toujours François qui réglait les
dépenses) ; puis il se moqua de 1ui :
- « T'es pas un homme; t'as peur de ta
femme... T'es donc pas l'maître ?.... »
Naturellement Chandel et Chochet venaient à
la rescousse ; bref, tous trois avaient si bien catéchisé le meunier que
maintenant il délaissait complètement le moulin au profit du cabaret.
Un jour que, très gris - ce qui était
maintenant son état presque habituel - il avait grossièrement et brutalement
répondu à sa femme, André avait cru pouvoir s'interposer et très poliment, mais
avec fermeté, lui avait dit combien sa conduite était blâmable. Le meunier
était devenu rouge de colère et tapant du poing sur la table :
« Toi ! dit-il, laisse-moi tranquille, t'a
pas la parole !... T'es rien, rien, rien du tout ici, t'entends !... »
Le pauvre garçon s'était levé et était monté
dans sa chambre en sanglotant. La meunière l'avait suivi pour le consoler,
sentant combien le coup avait dû lui être pénible... Le meunier retourna
retrouver ses camarades... Ce soir-là on le rentra à peu près ivre-mort. Hélas
! c'en était fait, François était devenu un ivrogne.
Sur les natures molles et sans énergie comme
celle du meunier, les passions malsaines ont une redoutable prise, les mauvais
compagnons une influence néfaste car ils flattent ces passions, les
entretiennent et les cultivent à leur profit. Bonne raison pour les écouter
tandis qu'on envoie promener les amis véritables qui voudraient les combattre
ou les corriger.
La meunière avait perdu toute influence sur
son mari. La pauvre femme se contentait de pleurer, ne se permettant plus la
moindre observation, car cela exaspérait François qui maintenant, toujours
surexcité, levait la main sur elle et menaçait de la battre à la moindre parole
de désapprobation.
André finissait sa dernière année d'école. Il
était triste et taciturne. La conduite de son père adoptif le désolait et il
était resté sous le coup de la brutale apostrophe du meunier. Ses anciennes
préoccupations lui étaient revenues ; derechef il songeait à sa véritable
situation et serait parti, n'importe où, si la présence de sa mère ne l'avait
retenu ; il sentait combien son affection était profonde et sincère et il se disait
que maintenant qu'elle était dans la peine, plus que jamais il devait rester
près d'elle pour la soutenir et la consoler.
Le frère de la meunière, « le Louis », venait
souvent au moulin, malheureux du malheur de sa soeur.
A plusieurs reprises il avait essayé de
raisonner François, de le ramener dans le bon chemin, lui faisant voir le
préjudice qu'il portait aux siens en même temps qu'à lui-même. Peines perdues ;
non seulement son beau-frère ne l'écoutait pas, mais il se fâchait, prétendant
faire ce qui lui plaisait.

La discussion un jour prit un tour si violent
que les deux meuniers faillirent en venir aux mains. Comme il fallait à tout
prix éviter un esclandre, Louis n'insista pas et se contenta de déplorer. Par
intérêt pour sa sœur il allait, à chacune de ses visites, passer une revue au
moulin et voir comment les garçons meuniers s'occupaient de leurs tâches.
Très attachés à leurs patrons, ceux-ci
faisaient de leur mieux mais, se sentant sans surveillance, ils se relâchèrent
petit à petit ; occupés par le travail du moulin, ils ne pouvaient guère du
reste aller voir les clients.
François maintenant ne rentrait le soir chez
lui que lorsque les cabarets lui fermaient la porte au nez.
Ereinté, abruti, il passait ses matinées au
lit, mangeait à peine et partait aussitôt pour ne revenir que fort avant dans
la nuit.
Des semaines, des mois s'écoulèrent ainsi.
Pendant quelque temps le moulin avait
continué à marcher, mais peu à peu il périclita. Les clients mécontents
s'adressèrent ailleurs et bientôt ce fut le chômage complet.
... Et François continuait son existence
vagabonde, dépensant tout son argent au cabaret, alors qu'il n'en rentrait plus
au moulin.
La meunière pleurait maintenant, non
seulement sur l'inconduite de son mari, mais sur la misère qu'elle prévoyait
prochaine.
André cherchait à la rassurer :
- « Sois tranquille, mère, je serai bientôt
un homme et je me sens plein de courage. Je ne veux pas que tu sois
malheureuse, je travaillerai au moulin et-je le ferai marcher. »
- « Cher, cher petit ! » se contentait de
répondre la meunière en hochant la tête !....
La malheureuse considérait avec terreur son
pécule s'en aller sou à sou ; elle faisait des prodiges d'économie mais voyait
la fin de sa bourse à brève échéance.
Les vacances étaient arrivées. Un jour que Louis était venu au moulin, André le suivit aux bluteries et lui dit :
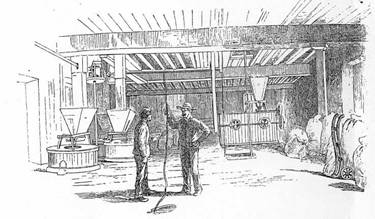
- « Mon oncle, je voudrais te causer
sérieusement.
- « A ton aise, garçon, de quoi s'agit-il ?
André alors lui dit son grand désir de
reconnaître par son travaille dévouement de sa mère adoptive ; il s'est mis
dans la tête qu'avant une ruine complète, il remontera le moulin.
- « J'ai de l'énergie, mon oncle, j'irai voir
les clients, je travaillerai, je ferai ce qu'il faudra mais j'arriverai ; seulement,
je ne connais pas le métier et je te demande à aller l'apprendre chez toi. Ici
on ne travaille plus, le garçon qui reste n'est pas capable de me guider, et
puis, la plupart du temps n'ayant rien à faire, il est absent. A ton moulin on
est actif. Tu me montreras tout, tu m'expliqueras tout, je serai ton garçon et
ton élève. Veux-tu ?
- « C'est bien ça, André, répondit l'oncle en
embrassant son neveu ; t'as du coeur et du courage... Tope-la. »
Ce qui venait d'être convenu fut mis à
exécution.
La meunière fut dans la désolation de voir
son André la quitter, mais elle comprit tout ce qu'il y avait d'affectueux
dévouement, dans la détermination du garçon qui, du reste, n'allait pas loin ;
le moulin de son frère était à quelques kilomètres seulement du Mesvrin, il
pourrait donc venir souvent et elle-même n'ayant, hélas ! plus grand'chose à
faire au Mesvrin, irait facilement le voir.
Trois jours après André était installé au
moulin du Louis.

CHAPITRE VI
AU MOULIN « DU LOUIS »
Le moulin, exploité par l'oncle adoptif
d'André, était situé entre Autun et Saint-Sernin.
On l'appelait « Gai-Moulin ».
C'était un ancien manoir d'assez belle
allure, transformé pour les besoins de la cause. Aux anciens bâtiments,
constituant le moulin proprement dit, on avait ajouté des constructions neuves
servant d'habitation au meunier, à sa famille et au personnel.
Le moulin justifiait son joli nom à cause de
son réjouissant aspect et sa belle situation d'abord, ensuite par le caractère
de ses habitants qui paraissaient y vivre fort heureux et y étaient heureux en
réalité.
Le meunier Louis était un franc compagnon
plein de belle humeur et de belle santé, aimant volontiers à rire et à
plaisanter toutes les fois que cela ne gênait en rien son travail ; chantant, sifflotant,
bavardant avec ses aides tout en faisant sa besogne et en leur faisant faire la
leur, il menait son moulin avec un superbe entrain, cachant sous sa joyeuse
nature, un caractère sérieux et actif.
Sa femme le secondait à merveille.
Tout en s'occupant de sa marmaille (une
fillette de huit ans, l'aînée, et deux garçonnets, l'un de six, l'autre de
trois ans, joufflus, bien portants, appétissants à croquer), elle se chargeait
des comptes du moulin et, ma foi, elle était aussi bon comptable qu'elle était
bonne mère.
Un seul livre suffisait à cette comptabilité,
tout à fait rudimentaire, du reste ; il portait pompeusement sur le plat une
large étiquette où la meunière avait écrit, en lettres aussi naïvement
fioriturées qu'orthographiées :
LIVRE DE CONTES
Du moullin Louis
DIT GAI-MOULLIN
Ce livre était aussi bien tenu, aussi propret que ses enfants. La meunière n'eût pas plus supporté un pâté sur page de chiffres qu'une tache sur une jupe ou une culotte et une écorniflure à un feuillet qu'un trou à un vêtement.
Dame Louise était, en somme, une maîtresse
femme. Très bonne, mais très énergique, voulant bien ce qu'elle voulait, elle
faisait, sans en avoir l'air, marcher tout son monde en poussant des «
mistenflûte ! » à tout bout de champ.
« Mistenflûte! » c'était son exclamation
favorite, elle l'employait à toute sauce, quand elle se fâchait, quand elle
était joyeuse.

Mistenflûte lui servait à appuyer, à
consolider sa phrase, à en augmenter la portée. Mistenflûte par-ci, mistenflûte
par là et chacun obéissait, y compris le meunier, lequel, reconnaissant les
qualités de sa femme, subissait volontiers son influence ; aussi l'appelait-il
gaîment « mon Gouvernement ! ».
- « O ben, disait-il, faudrait pas qu'jessaie
de faire comme le Berluchot, mon Gouvernement serait pas long à me donner ma
démission !... »
Le fait est que si la meunière du Mesvrin
avait possédé un peu de la fermeté de sa belle-soeur, si seulement elle l'avait
écoutée alors qu'elle l'engageait à réagir contre la légèreté de François, elle
en eût évité les tristes conséquences qu'elle déplorait aujourd'hui.
Aussi, tandis que le moulin Berluchot était
tombé en décadence, le moulin Louis prospérait de jour en jour.
Dès le lendemain de son arrivée à Gai-Moulin,
notre jeune garçon insista pour se mettre à l'oeuvre ; voulant tout apprendre
il se faisait tout expliquer, voulant tout comprendre il désirait tout voir ;
il avait demandé à l'oncle Louis de l'initier à chaque chose et d'agir avec lui
comme s'il n'avait jamais vu de moulin.
- « Bien mon neveu, avait répondu l'oncle, on
va commencer par le commencement alors. Tout d'abord on va te dire le nom des
choses, c'est utile ça, car faut s'comprendre entre meuniers. Il y en a, des
mots, que tu connais déjà à force de les avoir entendus au Mesvrin ; tant pis,
tu ne les sauras que mieux. »
Et Louis, conduisant André à l'extérieur, commença la nomenclature des termes usités en meunerie pour désigner les divers organes.
Il lui apprit qu'on nomme palettes ou
ailerons les planches qui reçoivent l'eau et font tourner la roue ; aubes,
celles qui sont fixées à la circonférence ; vanne, la porte qu'on ouvre ou
ferme pour laisser passer l'eau ou l'arrêter ; et chute, la conduite qui la
déverse; abée, l'ouverture par laquelle l'eau s'écoule; bouldure, la fosse sous
ta roue, bajoyers, les murs entre lesquels elle tourne.
Revenant alors dans l'intérieur du moulin il
lui fit voir la trémie par où on déverse le blé sur les meules ; le bailleblé,
petit cylindre par où il tombe sur celles-ci; la filoche, câble qui sert à les
soulever ; les cartelles, grosses planches qui les supportent, etc., etc.
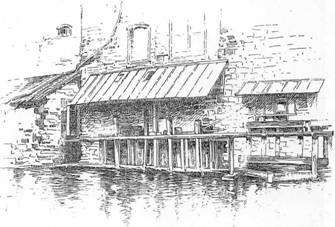
- « Et puis du reste, ajouta Louis, au fur et à mesure que nous travaillerons je te dirai les noms de chaque chose ; pour aujourd'hui tu en connais assez, faut pas vouloir en trop savoir d'un coup, on s'embrouille. Je vais maintenant t'expliquer comment avec du blé on fait de la farine.
« La première chose à faire quand le grain
arrive, c'est de le nettoyer, car il contient un tas de choses pas propres et,
quelquefois malsaines, des graines étrangères, des herbes sauvages, est-ce que
je sais ?... Eh bien ! regarde plutôt, dit-il, en lui montrant une poignée de
grains qu'il venait de prendre dans un sac nouvellement arrivé, v'là de
l'ivraie, des ravenelles, des nielles... » Et rejetant le grain dans le sac : «
Sans compter les insectes, les saletés de toutes sortes qui, moulus avec le
blé, feraient de la ch'tite farine !... Faut donc envoyer promener tout ça.
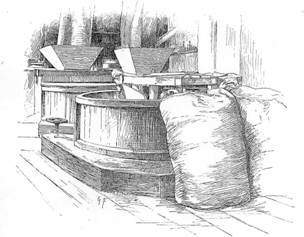
« Pour nettoyer et trier le blé on le fait passer
au travers de toiles métalliques aux mailles plus ou moins serrées ; le bon
grain passe d'un coté, de l'autre restent les blés cassés, les menues graines,
les saletés, les criblures en terme de métier. Ces criblures sont destinées aux
volailles qui se chargent à leur tour de les trier sans l'aide d'aucun
instrument; d'un coup de bec elles apprécient la valeur du mets qu'on leur
offre, avalent ce qui leur plaît et délaissent sans façons ce qui ne convient
pas à leur estomac.»
Louis ne se contentait pas d'expliquer
seulement, il faisait en même temps voir chaque ustensile, chaque élément, en
arrêtant au besoin un instant la marche pour bien en faire saisir les
manoeuvres.
Après le travail préparatoire du nettoyage,
le blé passe à la mouture.
On le déverse dans la trémie, sorte de grande auge carrée en bois, large d'en haut, s'amincissant par le bas, telle une pyramide renversée et tronquée.
La trémie est, en somme, l'équivalent d'un
vaste entonnoir placé au-dessus des meules ; on lui imprime un mouvement de
va-et-vient qui force le blé à descendre dans le baille-blé qui le répand entre
les meules où il est broyé. Lorsque le blé est concassé, il forme un mélange de
farine et de son. La farine est la graine réduite en poudre, le son est le
résidu des follicules du péricarpe broyé de cette graine. Il faut, maintenant,
séparer l'une de l'autre.
Des meules part une conduite qui dirige le
grain broyé vers la bluterie.
Ce mot de bluterie dérive de bluteau,
ustensile dont on se servait autrefois
pour séparer les diverses sortes de farine
et les débarrasser du son.
C'était un simple conduit garni d'étamine sur
son pourtour ; il était enfermé obliquement dans une huche où on lui imprimait de violentes secousses, la farine
voletait au travers de l'étamine ; les mailles étant trop serrées pour laisser
passer le son, celui-ci restait dans l'appareil au bas duquel il était entraîné
par son poids.
La bluterie, procédant du même principe,
n'est en somme que le perfectionnement du bluteau. Elle se compose d'une carcasse
hexagonale, en bois, dont les parois sont recouvertes de soie très fine, soie
spéciale qui s'appelle, du reste, soie de bluterie.
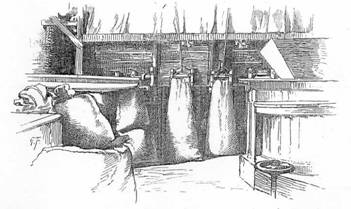
L'instrument est renfermé dans une caisse
hermétiquement close, nommée coffre ; monté sur un axe central, le coffre tourne
horizontalement, d'un mouvement rapide, tandis qu'il subit en même temps une
impulsion d'aller et retour.
Le même résultat se produit que pour le
bluteau; le son reste dans l'intérieur de la bluterie tandis que la farine
s'échappe au travers des mailles de la soie, remplissant de sa poussière
blanche le coffre qui l'emprisonne ; celui-ci est muni de petites portes en
guillotine, de glissières pour mieux dire ; on les soulève et la farine glisse
dans des sacs préalablement fixés devant. D'autres sacs reçoivent le son.
Les farines passent par plusieurs bluteries,
car on les divise par qualités ; plus une farine est fine, meilleure elle est :
farine première, deuxième, troisième. Puis vient la recoupe, c'est-à-dire la
farine grossière extraite du son.
Pour ce classement il faut des bluteries
recouvertes de soie de diverses grosseurs, à mailles très serrées pour la
farine de première qualité, plus écartées pour les autres.
Une paire de meules peut moudre environ 80
kilogrammes à l'heure.
Voilà pour ce qui concerne la mouture.
Le travail du meunier est tout d'attention et
de soins. Jamais un moulin ne doit rester seul, toujours le meunier ou ses
garçons doivent être présents.
Comme le moulin du Mesvrin, et la plupart des
moulins de campagne, Gai-Moulin employait l'eau comme force motrice.
Ouvrir ou fermer les vannes de l'écluse qui
laisse ou empêche l'eau de se précipiter
sur les palettes de la roue, c'est donc
mettre en marche ou arrêter le moulin.
La première besogne du meunier consiste à
ouvrir les vannes. Il lui faut ensuite verser le blé dans les trémies, veiller
à ce que toujours les meules soient alimentées, aller aux bluteries, retirer
les farines, les empocher, c'est-à-dire les mettre en sacs, fermer les sacs et
les transporter au magasin.
Le moulin comportant plusieurs étages, un
monte sacs, de simplicité primitive, y est installé. Il consiste tout bonnement
en une corde qui passe du haut en bas du moulin par des ouvertures percées les
unes au-dessous des autres dans les planchers. Le sac à charrier est fixé à
cette corde ajustée à un mécanisme mû par la force motrice ; il suffit de tirer
une ficelle pour produire un déclanchement qui fait monter ou descendre la corde et son fardeau.

L'outillage du moulin est simple : une sorte
de brouette à deux roues dénommée diable, servant à rouler les sacs ; une
bascule pour peser les marchandises qui arrivent ou s'en retournent, une grande
pelle en bois pour remuer son et farines, enfin une puisette en fer-blanc pour
la vente au détail.

Rien de gai comme l'intérieur d'un moulin de
campagne. Ces longues pièces à poutrelles saupoudrées de farine, ce tic tac
continuel qui fait tout remuer, même les
planchers, les allées et venues des meuniers, blancs comme tout le
reste, éveillent des idées réjouissantes.
Mais quiconque n'est pas « de la maison »
fait bien de regarder où il pose le pied ; d'abord les escaliers qui conduisent
aux étages supérieurs n'ont rien de confortable et sont raides à donner le
vertige, leurs marches encroûtées de farine sont glissantes en diable et on
fait bien de tenir la rampe, tout au moins la corde qui en tient lieu,
lorsqu'on en fait l'ascension. Ce n'est pas pour rien que le terme :
« échelle de meunier » est devenu synonyme de
« montée dangereuse ». Et lorsque l'on est arrivé à l'étage supérieur il faut
regarder devant soi: les planchers, sans compter les trous de rats, sont percés
d'ouvertures pour les montesacs, de conduites pour déverser le grain. Je
connais certain meunier qui, deux fois de suite, s'est enfourné dans une de ces
conduites où il se trouvait fort mal à l'aise ; comme il n'avait point de mal
on a beaucoup ri à ses dépens, mais lui, l'ex-meunier, ne se vante guère de
l'aventure.
Puis il y a les poulies, les arbres de
transmission, les engrenages qu'il ne faut pas frôler de trop près car leurs
caresses sont terribles et si les vêtements s'y font prendre le contenu ne
tarde pas à suivre le même chemin.
Un des garçons du meunier dont nous citons
plus haut l'aventure, voulant graisser un tourbillon de roue, se fit et bien
couper en sifflet le médius de la main droite.
Assez dur pour lui-même, il ramassa son bout
de doigt et s'en fut chez le meunier qui finissait de déjeuner :
- « J' vins d' mesteurpié, dit-il
tranquillement, j'mô coupé l' doigt ; yot d' ma faute, j'arrô dû arrêter pour
graisser !... tant pire pour moué. »
Le brave garçon a promené son bout de doigt
dans poche de son gilet pendant je ne sais combien de temps, tout fier de le
montrer à qui voulait le voir.
Ceci dit pour ceux de mes jeunes lecteurs
auxquels l'histoire d'André donnera envie d'aller voir un moulin ; qu'ils le
visitent, le parcourent, mais qu'ils fassent attention où ils posent leurs
pieds, où ils mettent leurs mains.
André fut vite au courant de tout ce qui
concernait le moulin.
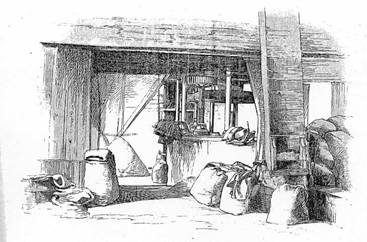
On le voyait maintenant dans son costume
blanc, les mains et la figure poudrées comme un pierrot, circulant sans cesse,
passant des meules aux bluteries, du magasin à farines au magasin à blé,
charriant des sacs sur les diables ou faisant manoeuvrer les monte-charges.
- « C'est pas tout, mon neveu, lui dit un
jour son oncle, t' v'la quasi bon meunier à c't' heure, faut que j'tapprenne à
rhabiller des meules, yen a une paire qu'en a grand besoin ; elles glissent
mais n'mordent plus. »
C'est qu'à force de tourner, elles s'usent,
les meules, et s'usent même relativement vite ; si le blé s'écrase, la pierre
s'émousse, se polit et ne broie plus.
Il faut donc strier les meules de rainures,
c'est là une des besognes du meunier ou des aides, besogne assez longue, fort
peu récréative, et qui demande une certaine adresse et beaucoup d'habitude.
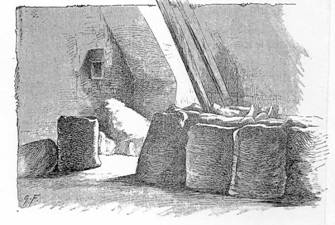
Les rainures, partant des bords, doivent
converger vers le centre. Au moyen d'une ficelle trempée dans du rouge on
commence à en indiquer la direction, en divisant la meule par rayons
rapprochés, puis on commence la taille.
Elle se fait avec un marteau double, en
acier, dont les deux bouts sont tranchants ; à petits coups on grave dans la
meule des incrustations formant de petites rigoles qui servent d'une part à
donner du mordant, d'autre part à permettre à l'air de circuler, sans quoi il y
aurait adhérence.
 Au
premier rhabillage qu'essaya André, affublé de larges lunettes (car les
lunettes sont indispensables pour ne pas recevoir d'éclats de pierre dans les
yeux), il fut un peu maladroit, ne savait trop comment tenir son marteau ;
l'oncle Louis dut venir à son secours plusieurs fois pour redresser les traits
mal posés ou accentuer ceux trop timidement creusés par notre apprenti. Mais
petit à petit il s'habitua à ce travail et bientôt s'en tira à son honneur.
Au
premier rhabillage qu'essaya André, affublé de larges lunettes (car les
lunettes sont indispensables pour ne pas recevoir d'éclats de pierre dans les
yeux), il fut un peu maladroit, ne savait trop comment tenir son marteau ;
l'oncle Louis dut venir à son secours plusieurs fois pour redresser les traits
mal posés ou accentuer ceux trop timidement creusés par notre apprenti. Mais
petit à petit il s'habitua à ce travail et bientôt s'en tira à son honneur.
Dans les moments de repos et lorsque les
moutards du Louis n'étaient pas à l'école, André s'amusait volontiers avec eux
; il leur fabriquait des jouets de sa façon, jouets rudimentaires mais
ingénieux, construits avec des débris de sacs, des brins de paille ou de
ficelle, des coquilles de noix, riens ramassés au moulin.
L'heure du travail sonnée, notre apprenti se
remettait à la besogne avec ardeur.
Quand on était en famille il était traité
comme le fils de la maison, mais, lorsqu'on était au moulin, lui-même entendait
qu'on le considérât comme un simple aide-meunier. C'est que le brave garçon
voulait non seulement rendre les mêmes services, mais il désirait apprendre
vite et bien tout ce qui avait rapport à l'état qu'il voulait embrasser.
Sentant là-bas, au Mesvrin, sa mère triste et
délaissée, voyant la misère la menacer, il n'avait pas de temps à perdre !...
CHAPITRE VII
UNE DECISION
 André
est au Gai-Moulin depuis six mois déjà. Il est devenu le bras droit du meunier
qu'il seconde assidûment et dont il a toute la confiance. Le meunier s'en
rapporte maintenant a lui pour la conduite du moulin, il peut plus facilement
s'absenter pour ses affaires ; aujourd'hui qu'André est là, il est tranquille.
André
est au Gai-Moulin depuis six mois déjà. Il est devenu le bras droit du meunier
qu'il seconde assidûment et dont il a toute la confiance. Le meunier s'en
rapporte maintenant a lui pour la conduite du moulin, il peut plus facilement
s'absenter pour ses affaires ; aujourd'hui qu'André est là, il est tranquille.
Le jeune homme s'était vite mis au courant et
connaissait très bien son métier.
Il faut dire aussi que, s'il avait été bon
élève, Louis avait été bon professeur.
Il ne s'était pas contenté de l'initier à
tout ce qui concernait le moulin proprement dit, il avait voulu lui montrer en
outre à faire ce qu'on pourrait appeler le « travail à côté » qui consistait à
confectionner certains outils, parer à certains accidents, fabriquer des pièces
usées ou détériorées.
Un grand hangar, au rez-de-chaussée, avait
été réservé pour ces petits travaux et servait tout à la fois de cellier et
d'atelier. Les futailles vides faisaient vis-à-vis à l'enclume, les tonneaux
pleins à la forge et à son soufflet, installés de façon primitive mais très
pratique ; des piles de bouteilles reposaient sur une couche de braise.
C'est là que Louis apprit à son neveu à
limer, tarauder, ajuster ; qu'il lui mit en main d'abord la chaîne du soufflet
tandis que, tous deux éclairés par les reflets du feu, le meunier faisait
rougir le fer .
Puis peu à peu, après quelques leçons, qui
n'allèrent pas du reste sans quelques brûlures et quelques pinçons pour le
novice, André s'essaya à forger lui-même, à battre le fer avec le lourd
marteau... Il fut fier et triomphant le jour où une pièce qu'il avait
confectionnée fut trouvée bien par « le patron » et servit à l'emploi auquel
elle était destinée.
Maintenant, dès qu'un élément quelconque ne
marchait pas dans la perfection, André cherchait d'où pouvait provenir le mal
et avait tôt fait de le réparer.
Bon travailleur, il savait aussi guider le
travail des autres, chose fort importante ; tout jeune qu'il était, les garçons
meuniers lui obéissaient, reconnaissant implicitement sa supériorité ; comme
naguère à l'école, il en imposait à ses camarades, sans qu'il fit rien pour
cela, aujourd'hui il en imposait aux aides qu'il avait sous ses ordres, lorsque
Louis était absent.
Souvent aussi il remplaçait celui-ci dans ses
visites aux clients et toujours ses missions étaient remplies avec succès.
Si le meunier se reposait absolument sur son
« premier commis », comme il l'appelait, la meunière, de son côté, se sentait
avec lui en pleine sécurité.
S'il était grave pour un meunier de confier
son moulin, il est plus grave encore pour une mère de confier des enfants.
Or, les jours de fêtes et les dimanches,
meunier et meunière n'étaient point fâchés de se reposer un peu, mais la
marmaille ne l'entendait pas de cette oreille-là et voulait sortir, courir à
travers champs, s'enfoncer sous bois.
André se chargeait de conduire les enfants et
c'était plaisir à le voir remplir son office de papa, menant son petit monde à
travers les sentiers, lui faisant sauter les ruisseaux, portant à califourchon
sur ses épaules le plus petit quand il était fatigué, tenant l'autre par la
main tandis que la fillette, plus grande et jouant déjà à la petite maman,
marchait gravement à ses côtés.
Et c'étaient sans cesse des interrogations
sur tout ce qu'on rencontrait, des « pourquoi » auxquels André répondait sans
se lasser jamais.
Et si l'un ou l'autre était un peu trop
turbulent, vite il était gentiment mais fermement rappelé à l'ordre, car André
avait conscience de sa responsabilité ; quand il sortait avec les enfants, il
répondait d'eux à leur mère, :mais il entendait que ceux-ci lui obéissent…. Il
n'avait pas grand'peine à obtenir cela, les enfants l'adoraient mais savaient
aussi que s'ils ne marchaient pas droit André renoncerait à les sortir.
Souvent André profitait de ses sorties pour
aller au Mesvrin. Hélas ! ces visites n'étaient point des parties de plaisir et
si ce n'avait pas été sa profonde  affection
pour sa mère adoptive, s'il n'avait compris combien celle-ci avait besoin
d'être consolée, réconfortée, i1 se fût plutôt détourné du chemin.
affection
pour sa mère adoptive, s'il n'avait compris combien celle-ci avait besoin
d'être consolée, réconfortée, i1 se fût plutôt détourné du chemin.
Les choses de ce côté allaient de mal en pis.
François s'est tout a fait dégradé ; il ne paraît plus au moulin que pour y
cuver son vin, le reste du temps, il le passe à boire avec ses compagnons
habituels, Thomas et les autres, qu'il a depuis longtemps surpassés en
débauche. De tous il est à présent le plus ivrogne.
Et pendant ce temps la pauvre meunière
pleurait, se morfondait.
L'argent est dissipé depuis longtemps et l'on
vient de vendre la dernière petite pièce de terre qui appartenait à Berluchot ;
le montant de la vente ira, comme tout le reste, se liquéfier encore dans le
verre du misérable.
La meunière du Mesvrin ne va plus au moulin
de son frère, elle éprouve une sorte de honte à se faire voir, elle si heureuse
autrefois, si malheureuse aujourd'hui !
C'est donc tour à tour André, Louis ou sa
femme qui vont à elle. C'est maintenant la misère profonde.
La pauvre meunière cherche à la cacher de son
mieux, à son André surtout. Elle se prive, mange à peine... quand elle mange.
Mais l'affection d'André est clairvoyante ; il devine à quel degré de dénûment
en est arrivée sa pauvre mère ; les douceurs, les friandises qu'il trouve moyen
de lui apporter à chacune de ses visites ne suffisent plus, les paroles de
consolation, d'encouragement, les promesses de revenir bientôt et de
reconstituer le moulin n'ont plus de prise sur la malheureuse qui hoche la tête
en souriant tristement; désespérée, elle ne croit plus au bonheur.
Plusieurs fois, en rentrant du Mesvrin, André
a aperçu François titubant sur la route en hurlant des refrains stupides ou se
vautrant dans les fossés... Il s'est détourné avec horreur.
La situation s'aggrave de jour en jour.
Exténuée par les larmes et les privations, la meunière s'affaiblit de plus en
plus ; il faut réagir à tout prix sous peine de la voir mourir de consomption.
André n'hésite pas, il sait combien l'oncle Louis et sa femme sont bons et
aiment sa mère. En rentrant un soir d'une visite au Mesvrin il leur dit
brusquement :
- « Il faut que cela finisse ! De deux choses
l'une, ou je vais retourner au Mesvrin vivre avec ma mère, ou il faut que ma
mère vienne au Gai-Moulin ; il y va de sa santé, et de sa vie !.... A toi de
décider, mon oncle, ce que nous devons faire.» C'est la meunière qui répondit :
- « Mais, mistenflûte, mon brave André, qu'y
ferais-tu, au Mesvrin, pour l'instant ?. Tu sais que nous sommes tout disposés
à t'aider, mais faut attendre encore un peu, c'est pas du jour au lendemain
qu'on peut ainsi tout changer. On s'en repose sur toi ici, maintenant, pour
aider au moulin ; en nous quittant brusquement tu nous mettrais dans l'ennui ;
faut au moins nous donner le temps de mettre quelqu'un au courant... C'est pas
toujours facile.
- « ... Mais ma mère ne peut plus vivre ainsi
!...
- « C'est bien mon avis! aussi il n 'y a pas
à hésiter, faut qu'elle vienne vivre au Gai-Moulin au moins quelque temps.
- « Je lui avais déjà demandé sans vous
l'dire, reprit Louis ; mais ma soeur a son idée, elle prétend qu'elle ne peut
pas abandonner son ivrogne de mari... Vrai, ça fait pitié.
- « Bien ! je me charge de tout, reprit
vaillamment la meunière, j'irai la chercher, moi, et je te réponds bien qu'elle
viendra. Quant à François, qu'il fasse ce qu'il voudra, je m'en moque.
- « Il couchera dans les fossés ou sur les
routes, ajouta le meunier. C'est pas ça qui l'embarrasse et ça ne s'ra pas la
première fois qu'ça lui arrivera, à ce misérable ; ce qui pourrait arriver de
mieux c'est qu'il y laisse sa peau ! »
André ne répondit pas, il pleurait
silencieusement. Il sentait combien le courroux de Louis et de sa femme contre
son père adoptif était justifié, mais il éprouvait, lui, plus de pitié que de
colère contre le malheureux qui, en somme, l'avait recueilli et avait été bon
pour lui.
- « C'est donc entendu, conclut dame Louise,
demain matin, tu attelleras la carriole et nous irons au Mesvrin... je te
réponds bien, mistenflûte, que nous n'en reviendrons pas rien que nous deux ! »

CHAPITRE VIII
L'ACCIDENT
Comme il avait été convenu, le lendemain, dès
qu'André eut distribué le travail au moulin, il fit atteler la carriole et
partit avec la meunière pour le Mesvrin, heureux à l'idée qu'il allait ramener
sa mère, qu'il l'aurait auprès de lui, se promettant bien de lui faire oublier
le plus possible, ses chagrins passés et faire renaître en elle l'espoir pour
l'avenir.
Ils étaient presque au croisement du chemin
qui du moulin va retrouver la route communale, lorsque le grondement d'une
corne d'automobile résonna tout près ; André n'eut que le temps de tirer de toutes
ses forces sur les rênes pour arrêter son cheval qui partait à un trot allongé
et se cabra, lorsqu'il vit passer, à vive allure, le bruyant véhicule laissant
derrière lui un épais tourbillon de poussière, une suffocante odeur de pétrole.
André calma de son mieux sa bête devenue
nerveuse, puis on se remit en route.
Comme on approchait du Mesvrin nos voyageurs
aperçurent à l'entrée du pont un rassemblement de gens du pays et, près du
moulin, des groupes séparés,  allant
les uns vers les autres, gesticulant, semblant discuter de façon fort animée ;
émergeant d'au milieu d'eux une voiture automobile était arrêtée.
allant
les uns vers les autres, gesticulant, semblant discuter de façon fort animée ;
émergeant d'au milieu d'eux une voiture automobile était arrêtée.
- « Y a sans doute quéqu'accident arrivé à
c'te vilaine machine, dit la meunière. Tiens ! ça m'a bien l'air d'être celle
qui nous a croisés tout à l'heure comme on sortait du moulin et qui a failli
faire emporter la Rousse... Mais, s'interrompit-elle, qui donc vient au galop
vers nous, là-bas ?... »
En effet un jeune garçon accourait aussi vite
qu'il pouvait ; dès qu'il fut à portée de voix il cria, tout essoufflé :
- « Ah ! te v'là l'André, j'allions te
chercher, y a malheur au moulin. »
André pâlit. « Dis vite, qu'y a-t-il ? ma mère...

- « Non! interrompit le gars, ta mère va
bien, mais c'est l'Berluchot qui s'est fait abîmer par la voiture mécanique que
v'la là-bas !... »
André n'en entendit pas plus long ; d'un
vigoureux coup de fouet il enleva son cheval et fila vers le moulin,

- les groupes s'écartèrent pour le laisser passer,
deux ou trois paysans le hélèrent... il ne prit pas le temps de répondre... au
galop il entra dans la cour du moulin.
Il jeta les guides à des gens du pays dont la
cour était encombrée et sans plus penser à la meunière qui l'accompagnait, il
courut vers la maison.
Il trouva là sa mère affalée sur une chaise,
sanglotant tandis que des voisines cherchaient à la consoler. Dans la pièce à
côté on entendait chuchoter et gémir. André s'informa de ce qui était arrivé,
et ce fut une voisine, témoin de l'accident, qui lui conta l'accident dans tous
ses détails.

François s'était étendu sur le rebord de la
route, les jambes traînant sur la chaussée. Ivre-mort, il n'avait entendu ni le roulement de l'automobile ni ses coups de
trompe ; la couleur de ses vêtements poussiéreux confondant avec celle de la
route, les voyageurs ne l'avaient vu que trop tard et les roues du lourd
véhicule avaient passé sur les jambes du malheureux qui ne s'était pas même
réveillé. Le sommeil de l'ivresse est profond à ce point, que celui qui y
succombe est anesthésié tout comme s'il avait pris du chloroforme, dont l'effet
n'est qu'une ivresse d'un autre genre. Cela est si vrai que lorsqu'on amène à
l'hôpital un blessé ivre-mort, on l'opère sous l'effet de la boisson sans
chercher à l'endormir autrement.

Dès qu'André eut été mis au Courant du
malheur, il se dirigea vers la pièce où on avait transporté le blessé.
Auprès du lit où il était étendu se tenaient
deux inconnus : le propriétaire de l'automobile et son chauffeur. Ils avaient
stoppé, sitôt l'accident, et, sur les  indications
des gens du pays qui en avaient été les témoins, ils avaient ramené le blessé
au moulin.
indications
des gens du pays qui en avaient été les témoins, ils avaient ramené le blessé
au moulin.
Le propriétaire de l'auto était un homme
entre deux âges, d'aspect distingué ; s'exprimant correctement, mais avec un
léger accent étranger, il donnait, au moment où André entra, des instructions à
son compagnon, lui ordonnant de remonter en voiture et d'aller à Autun à fond
de train chercher son médecin.
- « S'il n'est pas chez lui, mettez-vous à sa
recherche, mais coûte que coûte il faut me le ramener de suite...
Allons, vite, vite, partez ! ajouta-t-il en
le poussant vers la porte. »
Puis il revint se mettre debout devant le
lit, ne quittant pas des yeux le malade qui, sans se réveiller, poussait de
temps à autre de longs gémissements.
L'étranger alors se penche vers lui, lui tâte
le front, le pouls ; il est pâle et semble véritablement accablé. Parfois, d'un
geste impatient, saccadé, il serre les poings ou fait nerveusement claquer ses
doigts. - Dans le fond de la pièce des hommes et des femmes du pays, semblant
hypnotisés, se tiennent debout, silencieux, tout intimidés.
Quand André entra il se dirigea vers le lit,
doucement se pencha vers François qu'il embrassa sur le front en pleurant
silencieusement.
- « Vous êtes son fils ?.. » interrogea
l'étranger en se tournant vers lui. André fit de la tête un signe affirmatif.
- « Ah ! mon pauvre enfant !... Combien je
suis désespéré du malheur dont je suis la cause ; cause bien involontaire
pourtant, car nous marchions à une allure très modérée !... Pourvu qu'on me
ramène de suite ce médecin, s'interrompit-il !.. J'ai hâte qu'il donne des
soins à mon pauvre blessé, puis j'espère qu'il nous apprendra que l'accident
n'a pas la gravité que je redoute. Je suis bien malheureux, mon enfant, et
sincèrement navré du mal que j'ai fait et du chagrin que je suis venu causer
ici !... »
L'étranger se mit alors à marcher de long en
large, regardant sa montre à tout instant, murmurant entre ses dents: « Oh ! ce
médecin,... il n'arrivera donc pas ?.. »
Enfin le son d'une trompe d'automobile résonna dans lointain ; l'étranger se précipita vers la porte ; quelques secondes après l'automobile entrait dans la cour. L'étranger poussa un soupir de soulagement en apercevant le médecin qu'il conduisit aussitôt près du blessé, puis il pria les personnes étrangères de se retirer...
L'accident était grave ! L'amputation de la
jambe droite jugée indispensable, l'autre pouvait être sauvée.

CHAPITRE IX
LE PRÊT
Toutes les dispositions prises par André
furent, bien on pense, totalement renversées par l'accident arrivé Berluchot.
Il ne fallait plus songer maintenant à amener
la meunière du Mesvrin au Gai-Moulin, et André lui-même n'y pouvait retourner.
Il jugeait de son devoir de rester avec sa
mère et de ne pas lui laisser à elle seule le poids des soins à donner au
malade ; la pauvre femme était totalement anéantie, le nouveau malheur qui
venait de fondre sur elle la laissait inerte et sans forces.
La meunière de Gai-Moulin, femme énergique,
nous l'avons dit, et prompte à la décision, approuva André et malgré le vide
que son absence allait faire au moulin, malgré les services qu'il y rendait et
dont la privation allait les gêner tous, quelque temps au moins, elle comprit
qu'André devait rester auprès de sa mère et veiller sur son père. Elle s'en
retourna donc seule.
Tous les jours l'auteur de l'accident qui
habitait, avait-il dit, une propriété dans le pays, venait prendre des
nouvelles du malade ; on sent combien il est chagrin d'être cause d'un accident
qui met dans la peine toute une famille ; de son mieux il remonte le moral de
la meunière et console son fils avec lequel il cause volontiers.
Dès le premier jour l'étranger a nettement
déclaré qu'il entend être seul responsable de sa maladresse et que, tout
d'abord, tous les frais d'opération, de médicaments, de soins sont à sa charge.
Il n'a pas été long à s'apercevoir du
délabrement dans lequel se trouvait le moulin ; c'était d'autant plus
attristant qu'on sentait la ruine de date récente et qu'au travers de son
délabrement on retrouvait, de-ci, de-là, les vestiges d'une ancienne aisance .
Ce silence, si anormal dans un moulin
d'habitude bruyant et animé, cette cour déserte, étaient les preuves d'une détresse
vite devinée par l'étranger. Avec le plus grand tact, il y avait fait plusieurs
fois allusion dans ses conversations avec André pour lequel il éprouvait une
très réelle sympathie et dont la nature droite et ouverte l'avait subjugué dès
le début. Très fier, André n'avait jamais rien voulu dévoiler de la misère qui
régnait chez eux, ni surtout de sa cause occasionnelle.
Discrètement, l'étranger fit entendre à André
qu'en dehors des soins au malade il comptait bien le dédommager, lui et les
siens, aussi largement que possible et lui donna à comprendre qu'en cas de
besoin on pouvait sans crainte, dès à présent, avoir recours à lui.
Ces offres aimablement faites furent
aimablement repoussées.
L'étranger ne se rebuta pas, pourtant. Le
caractère d'André l'intéressait et il se sentait de plus en plus attiré vers ce
grand garçon dont les manières semblaient jurer avec sa modeste position.
Petit à petit il l'interrogea adroitement.
Petit à petit, André s'amadoua ; il s'était, lui aussi, pris d'affection pour le
nouveau venu qu'il jugeait bon et bienveillant et dans lequel il avait, sans
s'expliquer pourquoi, grande confiance.
Un matin qu'André se rendait à Saint-Sernin
pour faire quelques emplettes (le malade allant aussi bien que possible, André
pouvait maintenant s'absenter de temps en temps), il rencontra l'étranger qui,
tenté par le beau temps, avait laissé son automobile à quelques minutes de là
sous la garde de son chauffeur et s'en venait à pied en se promenant :
- « Tiens !... ou allez-vous par là, mon jeune
ami ?
- « Je monte à Saint-Sernin !...
-
« Ce qui
me prouve que notre blessé continue à aller bien !... Alors je vais faire le
voyage avec vous et nous reviendrons ensemble. »

La promenade est propice à la causerie. Peu à
peu l'étranger amena la conversation sur le moulin, le tort qu'allait faire à
son exploitation l'inaction forcée du meunier, etc.; bref il fit si bien qu'
André se décida à tout lui dire. Tout, mais non point son histoire à lui, - à
aucun prix il n'eût voulu la dévoiler, - mais il narra l'incident du
malencontreux héritage, l'entraînement de son père par de mauvaises relations,
son inconduite et finalement l'arrêt du moulin, la misère.
- « Mais maintenant, conclut André, je suis
un homme (André a seize ans), car les exemples et les malheurs m'ont vieilli,
je connais mon métier et je veux faire remarcher le moulin. Je travaillerai
jour et nuit s'il le faut, mais je veux que le moulin redevienne actif comme
autrefois, je veux que ma mère reprenne le calme, la tranquillité... et l'aisance,
ajouta-t-il plus bas.
- « Bien pensé et bien parlé, mon jeune ami,
vous êtes un garçon de coeur et d'énergie. Mais, avez-vous songé aux moyens
pratiques de mettre à exécution votre généreux projet ?....
- « Quels moyens ?... je travaillerai sans
relâche et il me semble...
- « C'est en effet, interrompit son
interlocuteur, le moyen principal, mais avez-vous réfléchi qu'on ne fait pas
marcher ainsi du jour au lendemain des organes rouillés, des machines démolies
qui refuseront tout service ? Or, pour les rendre propres à marcher derechef,
il y a fort à faire !
C'est que je le connais, le moulin, depuis
que j'y viens. Tout y est à renouveler ; la roue ne tient plus que par un
prodige inexplicable, il lui reste tout juste un tiers de ses palettes, encore
sont-elles pourries et prêtes à tomber, les murs sont en ruines, les toits
dégringolent ; tout cela n'est plus habitable que pour des rats, ils ne s'en
privent pas, du reste. Or, pour remettre en état un établissement aussi délabré
que votre pauvre moulin, il faut de l'argent…. et pas mal. - Et quand le moulin
sera réparé il faudra trouver du travail, il faudra faire des avances, il
faudra attendre les rentrées, il faudra, il faudra... Bref, il de l'argent...
et vous n'en avez plus guère, mon pauvre enfant !... »
André baissa la tête ; dans son juvénile
enthousiasme il n'avait pas pensé à tout cela. - II resta songeur.
L'étranger le laissa à ses rêveries, marchant
silencieusement à ses côtés, tout en le regardant de temps à autre à la
dérobée.
- « Voyons ! écoutez-moi, dit-il enfin en
tapant amicalement sur l'épaule de son jeune compagnon. II est bon d'avoir de
la fierté et du désintéressement, je suis heureux de voir que vous possédez
l'un et l'autre, mais en ceci comme en tout, l'excès est un défaut.
« Mettons les choses au point : Je suis
l'auteur involontaire d'un épouvantable accident, je fais ce que je peux, mais
hélas ! je ne puis réparer totalement le dommage. II est un proverbe que vous
connaissez où il est question de pots cassés ; or, ce qui est vrai pour les
pots doit l'être à plus forte raison pour les jambes. Donc au point de vue
légal, je dois payer à votre père la jambe dont je l'ai privé, je lui dois un
dédommagement puisque je l'ai rendu infirme... » Sur un geste d'André il
continue : « Mais laissons de côte la légalité et invoquons seulement la réelle
sympathie que j'éprouve pour vous... Cela vous va-t-il ainsi, dit l'étranger en
tendant la main au jeune homme ?..
- « Oh ! de tout mon coeur, répondit André en
serrant la main qu'on lui tendait.
- « Bien ! Alors je vous demande de me
laisser le très grand plaisir de collaborer à la réfection du moulin. Nous
procèderons à une toilette complète : on lui fera cadeau d'une roue superbe, on
le coiffera de toits rouges supportés par des murailles solidement refaites ;
nous aurons des meules de premier ordre, que le meunier André rhabillera avec
un talent remarquable, et qui transformeront en une farine fine les grains
qu'il ira chercher dans une charrette toute neuve attelée d'un robuste cheval.
Est-ce dit ?... »
André, tout ému de la générosité de
l'étranger et touché de la façon cordiale dont il offrait son concours, ne
savait que répondre.
- « Voyons ! vous avez encore des scrupules ?
reprit-il. Eh bien ! quoiqu'ils ne soient pas de saison, je les respecte et je
vais vous mettre tout à fait à l'aise ; après cela vous n'aurez plus aucun
motif d'hésitation :
« J'ai confiance en vous, j'ai foi en votre
intelligence et en votre énergie et je sais que ma confiance est bien placée.
« Eh bien ! je vous avancerai tous les fonds
nécessaires pour la remise à neuf du moulin, pour sa marche, pour son
exploitation, et quand les affaires prospèreront, quand vous serez en passe de
faire fortune, vous me rembourserez.
« Que diable, cette fois, maître André c'est affaire conclue !
« Et maintenant je souhaite, pour vous et les
vôtres, que vous fassiez fortune le plus
vite possible ; quant à moi, je puis attendre indéfiniment. Je suis trop riche
pour moi tout seul... et je suis seul hélas ! Tous les miens sont morts ou ont
disparu, ajouta-t-il tristement.
«... Nous voici arrivés au moulin, entrons
voir notre malade », reprit-il en partant en avant pour éviter à André de lui
répondre.
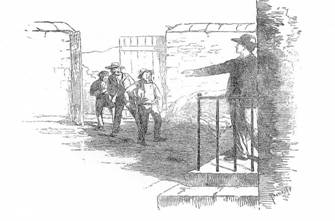
CHAPITRE X
A QUELQUE CHOSE MALHEUR EST BON
Le meunier allait aussi bien que possible,
les blessures de la jambe gauche se cicatrisaient peu à peu ; l'amputation de
la droite avait été faite avec succès, il n'y avait plus aucune complication à
redouter.
Plusieurs fois Thomas et ses deux
inséparables compagnons sont venus au moulin pour voir le blessé, mais ils se
sont heurtés à André qui, froidement, les a priés de se retirer.
- « Mon père n'est pas en état de boire avec
vous, allez donc boire sans lui !... »
Les trois compagnons se retirèrent, mais
quelques jours après revinrent à la charge. Thomas, plus hardi parce qu'il
était plus gris, laissa les autres à quelques pas en arrière et essaya de
forcer la consigne ; comme André lui barrait le chemin, il fit mine de le
bousculer pour entrer malgré lui :

- « Un pas de plus, dit celui-ci, et je vous
fais dégringoler les escaliers autrement vite que vous les avez montés ! »
Puis, le prenant par les épaules, il le fit pirouetter sur lui-même et lui
montrant la porte du doigt, lui dit avec un calme effrayant :
- « Mon père est malade ; tant qu'il ne sera
pas remis, je suis seul maître ici et tant que je serai le maître, je vous
défends, entendez bien, je vous-dé-fends de franchir la porte du moulin. »
Et il tourna les talons.
Thomas se le tint pour dit et fila rejoindre
ses deux camarades qui l'attendaient piteux, Chochet l'air plus abruti et plus
rébarbatif que jamais, Chandel riant plus bêtement encore que d'habitude ; bras
dessus bras dessous le trio d'ivrognes s'en alla noyer 1'affront dans quelques
verres ; mais plus jamais ni les uns ni les autres n'osèrent revenir au moulin.
Deux ou trois jours après la conversation
qu'André avait eue avec l'étranger, celui-ci, qui avait évité de lui reparler
de rien, préférant le laisser à ses réflexions, lui dit :
- « Eh bien ! André, quand commençons-nous à
faire la toilette du moulin ?... Votre père va de mieux en mieux, il n'a plus
besoin maintenant de votre présence continuelle, vous pourrez donc sans crainte
voir et surveiller les travaux.
- « Comme vous êtes bon, répliqua André, et
combien je vous remercie.
- « Taratata ! il ne s'agit pas de
remerciements mais d'une décision à prendre de suite et j'insiste d'autant
plus, pour commencer sans retard que je considère la réfection du moulin, non
seulement au point de vue de la situation que cela vous permettra de reprendre,
mais à un point de vue plus élevé. Lorsque votre père pourra se lever et
commencer à marcher, songez à l'effet moral que produira sur lui la
restauration complète du moulin qu'il avait laissé tomber en ruines ! Depuis
qu'il est malade, il n'a pu boire ni songer à boire, il n'a plus même, grâce à
vous et je vous en félicite, vu la figure des misérables qui l'entraînaient.
Or, à ce point de vue, - notez bien qu'en vous disant cela je ne veux en rien
essayer d'atténuer la gravité du malheur que j'ai causé - à ce point de vue,
dis-je, ce malheur aura peut-être pour l'avenir un effet bienfaisant.
« Votre père n'est heureusement, pardonnez le
terme, qu'un ivrogne d'occasion, buveur par entraînement d'abord, puis essayant
de noyer dans le fond de son verre les chagrins et la misère dont seul il est
l'auteur pourtant.
« Évitez-lui l'occasion, empêchez
l'entraînement, dissipez les chagrins, chassez la misère, et les causes ayant
disparu, l'effet n'a plus de raison pour se produire... Sapristi ! la leçon a
été trop dure pour qu'il l'oublie jamais ; la pauvre jambe de bois qu'il va
être forcé de porter sera là comme un triste souvenir de son inconduite passée.
- « Oh ! que vous me faites du bien en me
parlant ainsi, répondit André, comme ma pauvre chère maman serait heureuse si
vous disiez vrai... et vous croyez dire vrai, n'est-ce pas ?
- « Assurément ! et vous pourrez vous-même
aider à ce que ma prophétie s'accomplisse. Vous avez soigné votre père avec un
dévouement parfait ; vous avez su, en le soignant,
prendre sur lui une influence bienfaisante, même une certaine autorité ; conservez l'une et l'autre, usez-en et tout ira bien, je vous le garantis.
« Et maintenant que tout est entendu, dès demain je m'occupe d'envoyer
ici tous les corps d'état qui auront à intervenir dans notre nouvelle
installation. »

Le moulin du Mesvrin, si morne, si navrant depuis plusieurs années, a
pris tout à coup une extraordinaire animation, animation d'un nouveau genre.
Des camions chargés de pierres, de moellons,
de poutres, de ferrailles, entrent dans la cour où résonnent des « hues », des
« dias », où claquent des coups de fouet. Des maçons, des charpentiers, des
couvreurs sont juchés sur des murs, sur des échafaudages, sur des toits, des
mécaniciens occupent l'intérieur du moulin ; les sacs de sable et de ciment ont
remplacé les sacs de blé, la poussière lourde du plâtre tourbillonne là où
voletait la fine poussière des farines.
Les voisins et les voisines sont ahuris et
les moutards, bouches bées, les yeux ronds, regardent tout ce remue-ménage
comme des chats qui s'étonnent.
Berluchot, dans son lit, interroge :
- « Quoique c'est donc que tout c'bruit-Ià ?
- « Quoi donc qu'y ait dans la cour ?.. »
Comme on ne veut rien lui dire pour l'instant
et qu'il est convenu qu'on tient à lui laisser la surprise pour fêter son
rétablissement « physique et moral », a dit l'étranger, on lui donne d'abord
des explications quelconques : voisins qui déménagent, cultivateurs qui
passent, bref, tous les motifs à peu près plausibles qu'on a pu trouver.
Mais comme c'est pendant des jours et des
jours que les bruits inaccoutumés se font entendre, Berluchot finit par les
trouver étranges.
- « Tous les voisins déménagent donc ?
- « Mais non! c'est les cultivateurs qui
passent.
- « Ben !... yen ai jamais tant passé qu' ça
depuis que j'suis au Mesvrin... et c'est pas d'hier, ben sûr! »
André finit par donner enfin une raison qu'il
est surpris de ne pas avoir trouvée dès le début : Un habitant du pays fait construire
une maison à côté du moulin.
- « Il a ben d'la chance! » répond tristement
le convalescent.
Et de ce jour il ne s'informa plus.
Il songeait sans doute que s'il avait continué
à travailler comme jadis, lui aussi eût pu faire construire ; il ressentait de
cuisants regrets et se livrait, dans le calme où il se trouvait à présent, à
d'amères réflexions.
L'étranger venait constamment, surveillait
tout, donnait des ordres, avait l'oeil à tout ; on sentait en lui l'homme
habitué à commander le travail ; quand il quittait le moulin, il laissait à
André explications et instructions que celui-ci suivait à la lettre.
Ainsi conduites, les réparations marchèrent
vite et les couvreurs mirent sur les toits leurs drapeaux, indiquant la fin du
travail, quelques jours avant que le meunier pût enfin quitter le lit.
Cette première levée fut dure.
Le séjour prolongé au lit avait complètement
ankylosé le pauvre diable et il lui fallait en plus faire l'apprentissage de sa
jambe de bois et de ses béquilles.
- « C'est pas commode ces outils-là, dit-il
piteusement. C'est-y bête tout d'même de s'être mis dans l'cas de s'en servir !
»
Et songeant à sa vie de naguère :
- « C'est égal, l'père Thomas et les autr's y
n'sont pas les camarades que j'croyais ! Pas un qu'est seulement venu me voir
pendant que l'temps m'durait couché sur l'flanc... Tiens ! c'est décidément bon
qu'à boire, c'monde-là ! »
Inutile de dire qu'André et sa mère se
gardèrent bien de détromper le bonhomme et lui laissèrent, sans scrupules,
croire que ni Thomas ni ses compagnons n'avaient donné signe de vie. Quand de
temps à autre le meunier y faisait allusion, on se contentait de ne rien
répondre.
Petit à petit, Berluchot s'habitua à sa
nouvelle façon de déambuler. A l'aide de deux béquilles il s'essaya d'abord à
faire quelques pas, puis il n'en eut plus qu'une et enfin il put, sur sa jambe
de bois, circuler de pièce en pièce avec l'aide d'une canne. Sa gaieté alors
lui revint :
- « Me v'là pire que la Nanette ! à c't'heure
on s'ra deux dans l'pays à courir sur troès pattes. C'est la concurrence, quoi
!.. »
Dès que le meunier fut assez fort et assez
sûr de lui pour quitter sa demeure, on le conduisit au moulin. André, sa mère
et l'étranger l'accompagnaient.
Lorsque Berluchot vit tout reconstruit, tout
changé, il se mit à pleurer.
- « Ah! malheur, malheur! s'écria-t-il. C'est
donc ça qu'on m'a caché pendant que j'étais dans mon lit… Le moulin est vendu
et c'est un autre qu'en reconstruit un neuf à la place... Mon pauv'moulin ! »
dit-il en sanglotant.
- « Allons, allons, père, calme-toi, sois
raisonnable. Non ! le vieux moulin n'est pas vendu, non ! le moulin neuf n'est
pas à un autre, il est à toi, à nous si tu veux.
- « Quoi, quoi ! Quoi qu'te dis-là? » s'écria
le meunier les yeux écarquillés.
 - «
Votre fils dit la vérité, reprit l'étranger, mais il oublie d'ajouter que, pour
rester propriétaire de ce nouveau moulin nous avons pris pour vous un
engagement très sérieux.
- «
Votre fils dit la vérité, reprit l'étranger, mais il oublie d'ajouter que, pour
rester propriétaire de ce nouveau moulin nous avons pris pour vous un
engagement très sérieux.
- « Un engagement ??..
- « ... Celui-ci : vous ne boirez plus et
vous redeviendrez le brave et bon Berluchot d'autrefois. . . Est-ce dit?
« Ah! mâtin de mâtin, pour sûr que c'est dit!... j'ons ben assez de c'pilon-là, ajouta-il en tapant sur sa jambe de bois, j'ons point envie d'en aller ramasser eune autr'sur la grand'route.
- « Et plus d'ami Thomas, plus de Chochet,
plus de Chandel !...
- « Ah ben ! ces trois gaillards-là y peuvent
ben aller boire toutes les futailles de la Bourgogne et puis les autr's avec,
c'est ben sûr pas moi qui trinquerons avec eux. Fini, tout ça.
« Viens, la meunière, et embrasse-moi, te vas
avoir un meunier tout battant neuf comme le moulin. »

Est-il utile de dire avec quel bonheur la
pauvre femme embrassa son mari ?
- « Seulement, dit Berluchot, j'voudrais ben
tout d'même savoir comment mon vieux moulin est devenu un moulin tout neuf...
Fallait d'l'argent pour ça et, misérable que j'suis, j'avais tout gaspillé !...
»
André lui expliqua ce qui s'était passé.
Quand l'étranger avait vu la tournure que prenait la conversation, il s'était esquivé sans rien dire et lorsque Berluchot voulut le remercier, il avait disparu.
CHAPITRE XI
LE NOUVEAU MOULIN
André se mit de suite à la besogne. Il
s'agissait d'abord de trouver un bon garçon meunier qui pût le seconder et en
qui il pût avoir confiance quand il aurait à s'absenter.
- « Du reste, avait dit Berluchot, t'auras
pas à t'inquiéter, j'ferai l'surveillant, moi, puisque j'suis pus guère bon
qu'à ça ! »
Le fait est que le travail fatigant d'un
moulin nécessite des allées et venues perpétuelles, des montées et des
descentes sans nombre ne convenant guère à un éclopé.
- « J'pourrons encore rhabiller les meules et
recevoir les clients…. s'y veulent ben r'venir toutefois », avait-il ajouté.
André était enchanté des bonnes dispositions
de son père adoptif et se promettait bien, du reste, de lui trouver de menues
besognes possible pour un infirme ; il s'ingénierait même a en inventer au
besoin, car il craignait que si l'ex meunier restait oisif « le temps lui
durerait », comme il disait, et l'entraînement aurait de  nouveau
prise sur lui ; cela, il fallait à tout prix l'éviter.
nouveau
prise sur lui ; cela, il fallait à tout prix l'éviter.
Le meunier du Gai-Moulin et sa femme étaient
venus souvent au Mesvrin prendre des nouvelles du Berluchot. Dès le début des
pourparlers avec l'étranger, André, qui aimait beaucoup l'oncle Louis et avait
grande confiance dans sa droiture et dans son bon sens, l'avait mis au courant.
L'oncle fut sincèrement heureux de voir que
les choses allaient s'arranger et que la situation perdue pourrait être peu à
peu reconquise ; pour cela il avait foi en son neveu.
A chaque instant, pendant les réparations, on voyait arriver Louis au
moulin ; il inspectait d'un oeil de connaisseur et fut de grande utilité pour
certains aménagements qui demandaient les connaissances d'un homme de métier.
Quand tout, fut prêt, André lui demanda où il pourrait se procurer le garçon
qu'il lui fallait pour commencer.
- « J'ai ton affaire, mon n'veu ; mon premier
garçon que tu connais et qui est au Gai-Moulin depuis v'là bientôt six ans, a
son frère qui voudrait quitter le moulin où il est pour revenir au pays ; c'est
un garçon très capable et honnête, je l'connais, tu peux l'prendre les yeux
fermés. »
En attendant l'arrivée de son aide et
l'inauguration du nouveau moulin, André se mit en route tout joyeux d'essayer
son nouvel attelage ; il voulait aller voir tous les clients de jadis et tâcher
d'en amener d'autres ; bref, il fallait récolter des commandes et notre ami
s'était bien juré de ne pas rentrer sans avoir trouvé ample pâture pour ses
meules.
Il avait insisté auprès de sa mère et de
Berluchot pour que ceux-ci l'accompagnassent, mais il ne put les décider ni l'un
ni l'autre ; la meunière, toujours inquiète malgré tout, ne voulait pas laisser
son mari seul au moulin, elle redoutait en son absence la visite de Thomas et
de ses acolytes qui rôdaient constamment aux alentours ; Berluchot avait bien
juré de ne plus les recevoir et même de les envoyer au diable s'il les
rencontrait, mais la pauvre femme n'était pas tranquille.
Quant à Berluchot, il avait dit franchement à
André :
« Plus tard, j'irai voir les clients, mais
pour l'instant, ma jambe est en bois trop vert, j'aurais honte de la montrer,
j'aime mieux attendre qu'elle ait séché un peu. »
André partait donc seul tous les matins. On
le connaissait dans le pays, on l'estimait et on l'aimait. Il n'eut pas de
peine, dans ces conditions, à récolter des commandes un peu partout.
Quand le garçon meunier arriva, il y avait du
travail sur la planche et ce fut un jour de fête que celui -où on ouvrit enfin
la vanne pour lancer à gros bouillons l'eau sur les palettes de la nouvelle
roue qui se mit à marcher avec un train d'enfer.
L'étranger, l'oncle Louis, sa femme et ses
enfants assistaient à la mise en marche qui eut en outre pour spectateurs tous
les voisins et leur marmaille... De l'autre côté du pont, Thomas et ses
inséparables compagnons, aux trois quarts gris, regardaient d'un mil éteint
sans oser s'approcher, car ils craignaient quelque rebuffade d'André.
Tout marcha à souhait ; André tenait à
honneur de diriger tout ; il s'en tira à merveille et fut triomphalement sacré
: « Meunier du Mesvrin ».
 Peu
à peu le moulin reprit son aspect d'autrefois ; les tic tac y résonnèrent à
nouveau. Sans relâche des sacs de blé entraient ; les sacs de farine s'en
retournaient de même et comme autrefois des nuages blancs, s'échappant d'un peu
partout, ouatèrent bientôt de leur fine poussière les toits et les murailles,
dissimulant sous leur couche légère le rouge des tuiles neuves, les jointures
refaites des moellons et les moellons eux-mêmes.
Peu
à peu le moulin reprit son aspect d'autrefois ; les tic tac y résonnèrent à
nouveau. Sans relâche des sacs de blé entraient ; les sacs de farine s'en
retournaient de même et comme autrefois des nuages blancs, s'échappant d'un peu
partout, ouatèrent bientôt de leur fine poussière les toits et les murailles,
dissimulant sous leur couche légère le rouge des tuiles neuves, les jointures
refaites des moellons et les moellons eux-mêmes.
Berluchot tenait parole ; il trouvait à s'occuper au moulin, rhabillait les meules, surveillait les bluteries, fermait les sacs, les pesait ; bref, les affaires marchant bien, il y avait toujours pour lui quelque occupation qu'il faisait gaiement, chantant comme au bon temps, ne sortant du moulin que pour aller se promener près de l'étang en fumant sa pipe ; il y rencontrait souvent la Nanette baignant ses oies.

- « Dis donc, la Nanette, lui disait
Berluchot en riant, y m'est v'nu eune idée, veux-tu que j'te la dise ?...
- « Dis toujours, on verra ben c'qu'elle vaut
ton idée.
- « Eh ben, si t'veux, l'jour de la fête
c'est nous deux qu'ouvrirons l'bal ; j'te ferons vis-à-vis pour le quadrille,
ça va-t-il ? ...
- « J'veux ben ; mais j's'rons p'tête pus
valide avec mon bâton que toé avec ta quille, mon gars ! »
Le meunier aimait taquiner la Nanette, mais
celle-ci, pas bête, avait généralement le dernier mot.
 La
journée terminée, les Berluchot passaient la soirée entre eux ou avec des
voisins qui venaient bavarder quelques instants tandis que, la Nanette, des
lunettes sur le nez, reprisait quelques hardes ou tricotait des bas: « Té l'air
d'un vieux maît'd'école avec tes verres sus l'nez, lui dit le meunier. »
La
journée terminée, les Berluchot passaient la soirée entre eux ou avec des
voisins qui venaient bavarder quelques instants tandis que, la Nanette, des
lunettes sur le nez, reprisait quelques hardes ou tricotait des bas: « Té l'air
d'un vieux maît'd'école avec tes verres sus l'nez, lui dit le meunier. »
- « A ton service pour te donner des l'çons,
l'meunier », riposta celle-ci.
Mais bavardages et taquineries ne duraient
guère, car on se couchait tôt pour être tôt sur pied et reprendre la besogne
dès le soleil levé.
Parfois le travail pressait et le moulin
marchait la nuit, tour à tour André ou son garçon veillait.
Berluchot se retrouvait tout heureux.
- « Mâtin, de mâtin ! j'avons t'y été bête,
j'avons t'y été bête !... et dire que sans toé, ma vieille, s'exclamait-il
parfois en tapotant sur sa jambe de bois, j'courrons p'tête encore les chemins
avec Thomas et les autr's !... »
La meunière était tout à fait remise ; sa
santé lui était revenue au fur et à mesure que la tranquillité renaissait au
moulin et les sillons creusés par les larmes avaient disparu en même temps que
les lézardes des murailles.
Le nouveau meunier était d'une activité remarquable,
si bien que peu de mois après la remise en marche du moulin, lui et son garçon
ne suffisaient plus et qu'il fallut engager un aide supplémentaire pour le
travail intérieur et un charretier pour le transport des blés et des farines.
Peu à peu Berluchot se remit à aller voir des
clients ; un peu honteux au début, il se contenta d'abord d'accompagner André,
puis enfin se reprit à faire seul les tournées ; il faut lui rendre cette
justice que toujours il rentrait à l'heure et toujours de sang-froid. André, du
reste, lui avait doucement rappelé l'engagement pris et l'avait averti que «
l'étranger » avait le droit de fermer
définitivement le moulin et d'en emporter les clefs si tout ne marchait pas
suivant les conventions prises.
- « Dors paisible, garçon, avait répondu
Berluchot, c'est juré et mes bêtises m'ont coûté trop cher pour recommencer...
et puis c'est drôle, j'ai pus jamais soif à c'te heure! »
Le fait est que l'ex-meunier ne buvait plus.

CHAPITRE XII
LA MÉDAILLE
L'étranger venait souvent au moulin et
s'intéressait vivement à son succès.
- « Ne vous étonnez pas de mes nombreuses
visites, dit-il gaiement à André, mais vous savez que je suis un créancier fort
méfiant ; or, il est juste que je vienne surveiller ma créance... Allons! allons
! tout va bien, je vois que mes fonds
sont en sûreté... » et il envoie au jeune meunier une claque amicale.
Vers la fin d'un après-midi d'été, après une
journée d'accablante chaleur, André se délassait en se baignant dans l'étang ;
il nageait, faisait des coupes, plongeait, quand survint l'étranger ; en se
rendant à Saint-Sernin, il avait fait un crochet pour passer au moulin.
Apercevant André dans l'eau, il le héla.
- « Eh ! l'heureux mortel qui fait l'amphibie
tandis que je cours les grands chemins... Ma parole d'honneur, il me donne
envie de sauter à l'eau avec lui. »
André s'avança et pour répondre à son
interlocuteur, découvrant son torse nu, il se hissa sur l'arrière d'une barque
qui lui servait de tremplin. L'étranger s'approcha mais tout à coup resta comme
figé sur place.
Il a pâli, semble en émoi ; fixement il
regarde la poitrine d'André, ne songeant même pas à serrer la main que celui-ci
tient tendue vers lui.
André, étonné, le considère.
- « Mais Monsieur, qu'avez-vous ?
- « Cette médaille, cette chaînette... d'où
avez-vous cela ?... depuis quand ?... vite répondez-moi », dit-il enfin d'une
voix tremblante en indiquant du doigt le joyau qu'André porte au cou.
Interloqué, André saute sur la berge où
l'étranger le rejoint, l'attire à lui et se met à examiner anxieusement le
collier, la médaille.
- « De grâce, André, répondez-moi
franchement, je vous en prie, d'où vous vient ceci ?.. »
Comme deux ou trois villageois, témoins de la
scène faisaient mine de s'approcher, André répondit, tout en passant vivement
ses vêtements :
- « venez avec moi au moulin, Monsieur, ma
mère et moi nous vous expliquerons...
- « Faisons vite, alors ! »
Et tous deux entrèrent au moulin.
Là, sans omettre un détail, en précisant les heures,
les dates, dont elle se souvenait à merveille, la mère adoptive d'André raconta
toute son histoire : la trouvaille de l'enfant par la Nanette, son arrivée au
moulin, son adoption, les chagrins d'André à la suite d'une discussion à
l'école, ses souvenirs, ses rêves, la confidence qu'elle, la meunière, lui
avait faite, puis enfin la remise de la médaille et de sa chaînette qui depuis
ne l'avaient plus quitté.
L'étranger n'a pas dit un mot, n'a pas un
instant interrompu ; ses yeux ne quittaient la narratrice que pour se fixer sur
André.
 Quand
enfin la meunière eut fini son récit, il se leva, et prenant André dans ses
bras il le serra contre lui en l'embrassant fougueusement.
Quand
enfin la meunière eut fini son récit, il se leva, et prenant André dans ses
bras il le serra contre lui en l'embrassant fougueusement.
- « Mon petit André, mon cher petit homme
!... je ne m'étonne plus de la sympathie que je ressentais pour toi !... le
sang parlait en moi, car tu es mon neveu, mon neveu que je croyais perdu à tout
jamais.
« Tiens, reprit-il, en déboutonnant son gilet
et en entr'ouvrant sa chemise sur sa poitrine, regarde, je porte une médaille
semblable à la tienne quant au nom, à l'emblème, à la chaîne, différente
seulement par la date et la localité ; moi aussi, je m'appelle André, André
Dourlan comme toi. »
Et à son tour, il conta à André l'histoire de
ses premières années, complétant ainsi le récit que lui-même venait d'entendre.
- « Ton père s'appelait Pierre Dourlan ; il
était plus jeune que moi de huit ans ; j'en ai aujourd'hui cinquante-deux.
« J'avais pour lui une profonde affection
qu'il méritait à tous égards ; aussi, dès que les circonstances le permirent,
je l'associai à une grosse affaire industrielle que j'avais créée à Baltimore,
aux États-Unis, - d'où le nom de Baltimore et les initiales U. S. gravées sur
la médaille ; U. S. est l'abrégé de United States qui signifie Etats-Unis.
« Nos affaires prospéraient au delà de nos
désirs et nous vivions heureux ; ton père, lors d'un voyage en France, avait
épousé la charmante et excellente femme qui fut ta mère.
« Tu vins, toi mon petit André, augmenter
encore le bonheur de tes parents en faisant ton apparition ; j'étais tout
désigné pour être ton parrain - car tu es non seulement mon neveu, mais de
plus, mon filleul, - et c'est pour consacrer ce parrainage que je voulus, en
dehors de ce que je te réservais par la suite, te donner un souvenir bien
personnel et tout à fait intime. Comme fils aîné j'avais hérité de mon père
d'une médaille que j'ai toujours portée depuis sa mort, que lui-même tenait de
son père et qui ne l'avait jamais quitté non plus. Cette médaille, pour rien au
monde je ne m'en fusse dessaissi, elle devait revenir à mon fils, si j'en avais
un... hélas ! le destin a voulu que je restasse garçon, ma médaille sera donc
enterrée avec moi.
« Ne pouvant te donner le bijou que je
portais, j'en fis confectionner un identique (modifiant seulement la date et le
lieu) et moi-même, lorsque je te tins sur les fonts baptismaux, je te passai au
cou la chaînette qui la soutenait.
« A nous quatre, ton père, ta mère, toi et moi, nous menions une existence charmante et rien ne pouvait faire prévoir qu'une épouvantable catastrophe allait la bouleverser à tout jamais, qu'à tout jamais notre bonheur allait être englouti.
« Tu avais environ deux ans, et tu étais un
joli bambin rieur et bien portant, lorsque tes parents décidèrent de venir en
France passer deux ou trois mois. Ta mère désirait revoir les siens ; toute
fière d'être la jeune maman d'un superbe moutard, elle désirait qu'on le vît,
ce moutard... touchant orgueil maternel qui fut pour beaucoup dans la décision
du voyage!...
« Joyeusement on prépara les bagages et
joyeusement, le jour du départ arrivé, on s'embarqua.
« Tes parents emmenaient avec eux ta nourrice
- ou ta bonne, pour mieux dire, car ta mère a tenu à te nourrir elle-même - et
deux domestiques.
« Ton père et moi nous avions fait le tour du
monde, nous savions donc ce que c'était que voyager ; aller d'Amérique en
France était pour nous presque une promenade.
« Je montai sur le bateau avec vous tous,
j'aidai à vous installer confortablement et je ne quittai le pont que lorsque
la cloche annonça le départ.
« Longtemps je suivis des yeux ce bateau qui
emmenait tout ce que je chérissais au monde, longtemps tes parent sur le pont
et moi sur le port nous nous fîmes des signes affectueux et je te revois
encore, toi, mon petit André, serré dans les bras de ta nourrice et ta mère
debout à côté de toi, prenant ta petite menotte et l'agitant tandis qu'elle te
faisait crier « au voir » « au voir! ». Il me semblait entendre aussi
distinctement tes adieux que lorsque tu me les envoyais d'une fenêtre ou du
perron de la maison.

« Hélas ! je viens de dire le mot, c'étaient
des « adieux » que nous nous faisions sans le savoir..., tes pauvres parents et
moi au moins, nous ne devions nous revoir jamais.
« Je te l'ai dit, ton père, qui comme moi
avait parcouru toutes les mers, était resté en bateau pendant des mois
consécutifs, avait essuyé des tempêtes de plusieurs jours et qui était toujours
sorti indemne de tous les dangers courus, devait, fatalité ! mourir dans une
traversée d'une semaine !... « Non loin des côtes de France, une nuit de
brouillard, navire qui le portait, lui et les siens, entra en collision un
autre et coula.
« Une partie des passagers fut sauvée,
d'autres périrent ; ton père et ta mère furent de ceux-là, j'en ai la triste
certitude !....
« Je n'avais jamais pu, malgré toutes mes
recherches, avoir à ton égard aucun renseignement et j'étais persuadé que tu
avais subi le même sort que tes pauvres parents !.... »
André en écoutant ce récit, était livide, il
sanglotait ; peu à peu il s'était rapproché de son oncle et se serrait contre
lui.
- « Comment, par qui fus-tu sauvé ?.... Cela,
nous ne le saurons jamais ; en tout cas ta pauvre nourrice ne t'avait pas
abandonné, car la pauvre femme trouvée morte dans la rivière c'était elle.
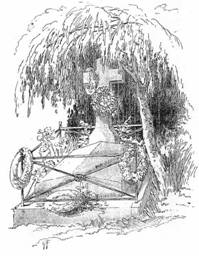 «
Je suppose qu'après l'horrible désastre auquel elle avait assisté, la
malheureuse aux trois quarts folle, ayant perdu ses maîtres, ne sachant que
devenir, n'aura eu qu'une idée fixe, revenir dans son pays.
«
Je suppose qu'après l'horrible désastre auquel elle avait assisté, la
malheureuse aux trois quarts folle, ayant perdu ses maîtres, ne sachant que
devenir, n'aura eu qu'une idée fixe, revenir dans son pays.
« Par suite de quelles circonstances y a-t-elle
péri de mort tragique, elle aussi ?
Comment l'accident a-t-il pu se produire ?
Cela aussi restera obscur pour nous et nous en sommes réduits aux suppositions.
« En tout cas, après tes pauvres parents,
c'est à elle qu'il faudra garder le plus pieux souvenir ; ensemble nous
veillerons à l'entretien de sa tombe, car c'est à elle, mon cher enfant, que
nous devons de nous revoir. »
Tout heureux d'avoir retrouvé son neveu qu'il
croyait perdu à tout jamais, M. Dourlan ne se lassait pas de le regarder, de le
serrer dans ses bras ; André lui rendait ses effusions, mais tous deux étaient
fort émus et leur joie était voilée de tristesse.
André venait d'apprendre les pénibles
circonstances dans lesquelles ses parents avaient trouvé la mort, son oncle
venait, par son récit, de raviver chez lui-même le chagrin d'autrefois, chagrin
non point éteint mais endormi seulement.
La catastrophe avait beau être lointaine, les
années avaient eu beau passer, M. Dourlan n'avait point oublié, et l'image des
pauvres disparus restait vivace en lui. André ne se souvenait pas de ses
parents, tout au moins ses souvenirs étaient-ils bien vagues et bien confus,
mais il n'en ressentait pas moins une douleur vive ; en apprenant qui étaient
ses parents, il apprenait aussi qu'ils n'existaient plus, qu'il ne devait
jamais les connaître... Et silencieusement pleurait !
Enfin M. Dourlan reprit son empire sur
lui-même :
- « Né dans ce pays j'ai voulu, mes affaires
d'Amérique liquidées, venir m'y reposer ; j'ai acheté, non loin d'Autun, une vaste
propriété où tu viendras habiter avec moi, car maintenant que nous nous sommes
retrouvés, mon petit André, nous n'allons plus nous quitter, j' espère ! Je
t'ai perdu, je t'ai pleuré. Aujourd'hui je te retrouve, - je te garde ! je
t'emmène. »
 A
ces mots la meunière, qui tout émue était restée à l'écart, pâlit et laissa
échapper un san-glot. En entendant ces mots : « Je te garde, je t'emmène ! »
elle s'était dit qu'André, son fils, son enfant malgré tout, était perdu pour
elle.
A
ces mots la meunière, qui tout émue était restée à l'écart, pâlit et laissa
échapper un san-glot. En entendant ces mots : « Je te garde, je t'emmène ! »
elle s'était dit qu'André, son fils, son enfant malgré tout, était perdu pour
elle.
Mais à la plainte de sa mère, André s'était
élancé, l'avait serrée contre son coeur, puis se tournant vers son oncle :
- « Et maman ? avait-il simplement répondu.
- « Mais, mon enfant, dit M. Dourlan, tu
viendras la voir aussi souvent que tu voudras !...
- « Vous voulez donc que je la quitte ?...
Écoutez, mon oncle, je sens que j'éprouve pour vous une affection qui ne peut
que s'augmenter maintenant que je sais qui vous êtes, mais ne me demandez pas
d'abandonner ma mère, je l'aime trop et elle m'aime trop aussi pour vivre sans
moi.. Est-ce vrai, mère ?... »
La pauvre meunière ne répondit qu'en prenant
son André par le cou.
- « Allons ! bravo, mon neveu, j'en étais sûr ! tu es bien le grand
coeur, le loyal caractère que je supposais. Je t'approuve et tu aurais agi
autrement que j'aurais éprouvé sur ton compte une grande désillusion.
« Eh bien! à présent que je suis sûr de tes
sentiments, nous allons arranger les choses vite et pratiquement.
« A l'américaine ! mon neveu, dit-il en
souriant. D'abord, que veux-tu faire ? tu es mon neveu, mon filleul, mon
héritier... trois titres suffisants pour que je fasse pour toi tout ce que tu
me demanderas de raisonnable, réponds donc hardiment.
- « Eh bien ! meunier je suis, meunier je
veux rester !
- « Tu veux être meunier ?...
Bien ! nous monterons une minoterie - premier
point.
« Second point : tu ne veux pas quitter ta
mère... ni ton père adoptifs ? entendu, ils habiteront la minoterie. Maintenant
à mon tour, je suppose que tu ne voudrais pas « reperdre » ton oncle qui, lui,
ne s'en soucie pas non plus ? Bien ! L'oncle aura son pavillon attenant à la
minoterie dont il sera le directeur « honoraire ». Que faut-il encore ?..

- « Et notre pauvre Nanette ? répondit André.
- « C'est vrai ! la Nanette !... tu n'oublies
personne et je m'accuse de n'avoir pas pensé de suite à la brave femme qui fut
ton sauveur au Mesvrin... Eh bien ! nous emmènerons la Nanette ; on lui
achètera un troupeau d'oies, un régiment de dindes, des canards, des poules,
des pintades, tous les bipèdes ailés qu'elle voudra ; elle sera le régisseur en
chef de la basse-cour, on mettra sous ses ordres des gardiennes attitrées et
nous lui organiserons un confortable petit appartement où elle vivra heureuse
et tranquille ; de ses fenêtres, elle surveillera ses surveillantes et assistera
aux ébats de ses volailles.
« Cet arrangement te plaît-il, mon neveu ?... Oui ?... Est-ce tout ?... alors embrasse-moi. C'est affaire conclue. »
CHAPITRE XIII
ÉPILOGUE
André, qui a perfectionné ses études, est aujourd'hui
à la tête d'une superbe minoterie, la plus belle et la plus importante du
département ; elle marche au delà de ses désirs.
Il doit se marier prochainement.
L'oncle Dourlan partage son temps entre le
voyage qui est sa plus chère distraction, et le séjour à la minoterie qui est
son plus doux repos.
La maman Berluchot se laisse choyer et
dorloter par « son André » dont elle est si fière ; elle est superbe de santé
et rayonnante de bonheur.
Quant à Berluchot, il s'est donné le titre de
surveillant en chef ; il va, vient à travers les ateliers, jette un coup d'oeil
par-ci, donne un coup de pouce par-là ; en somme il se laisse vivre et se
trouve fort heureux ; il ne boit du vin qu'aux jours de fête. Habitué à sa
jambe de bois - il a une jambe de bois toute neuve, s'il vous plaît, tout à
fait perfectionnée, articulée, superbe et marche sans bâton - il fait la nique
à la Nanette !
La brave femme l'a toujours conservé, son
bâton, mais il lui sert rarement car elle se fait bien vieille, la pauvre, et
ne sort plus guère. Mais on vient la voir. C'est l'ex-meunière qui vient causer
avec elle, c'est Berluchot qui vient la taquiner, c'est André qui lui apporte
des douceurs, c'est même M. Dourlan qui monte prendre des nouvelles de « Mme la
Douairière », ainsi qu'il l'a surnommée.
- « Quoiqu'c'est que c'nouveau nom-là ?
a-t-elle demandé ; Troé-Pattes j'comprenais ben, mais c'mot-là j'y sais pas
c'qu'y veut dire. »
André a essayé de lui expliquer; mais la
bonne vieille n'y comprenant rien, il a renoncé à ses explications.
Le moulin du Mesvrin marche toujours, André
l'a, en tant que moulin, cédé à son premier garçon qui y fait très bien ses
affaires, mais l'a conservé en tant que propriété ; le cher moulin renferme
trop de souvenirs, il n'entend pas qu'on y change rien. C'est très souvent pour
lui et les Berluchot un but de promenade qu'ils font toujours les uns et les
autres avec un réel plaisir.
Les meuniers Louis se sont retirés des affaires et vivent de leurs rentes ; c'est aussi leur premier garçon, le frère de celui du Mesvrin, qui maintenant dirige son moulin.
« Le Louis » et sa femme viennent pendant les
vacances des enfants passer quelques jours à la minoterie ; on leur fait fête
quand ils sont là.
Quant au père Thomas, il a fini par lasser
son patron qui un soir l'a bel et bien laissé choir dans la rivière, la tête la
première. Le dieu des ivrognes était sans nul doute très occupé à ce moment (il
faut l'excuser, il a tant de besogne ayant tant de fidèles !), car il ne vint
point au secours de notre homme qui mourut d'avoir avalé trop d'eau ; ironique
destin pour un gaillard qui aimait tant le vin.

La mort de leur chef de file a été pour Chandel et le père Chochet l'occasion d'une « beuverie » formidable... Il fallait bien se consoler !... mais leur douleur est si profonde qu'ils continuent à s'administrer de liquides consolations et, chose singulière, plus ils se consolent, plus ils sont tristes... C'est un cercle vicieux dont ils ne se tireront l'un et l'autre qu'en rendant au bord de quelque fossé ou au pied de quelque « boûchure », leur dernier hoquet.


TABLES DES
CHAPITRES
Une querelle 1
Le moulin du Mesvrin 7
L'enfant trouvé 19
Promenades aux champs et à la ville 34
Les suites d'un héritage 41
Au moulin « du Louis » 56
Une décision 71
L'accident 77
Le prêt 84
A quelque chose malheur est bon 91
Le nouveau moulin 101
La médaille 108
Epilogue 119

1072 – EVREUX IMPRIMERIE CH.
HERISSEY. – 8-26
